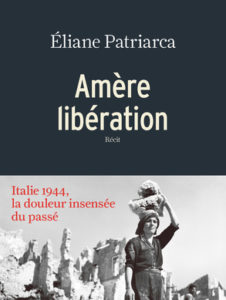 Éliane Patriarca
Éliane Patriarca
Paris, Éditions Arthaud, 2017, 228 p.
La Ciociara, le film que Vittorio de Sica réalisa en 1960 d’après le roman-reportage d’Alberto Moravia, est régulièrement projeté sur les écrans. Célèbre pour sa prestigieuse distribution (Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo), il l’est moins semble-t-il de nos jours pour le « côté obscur » de la campagne d’Italie que le réalisateur italien révèle au spectateur. Publié en mai 2017 aux éditions Arthaud, Amère libération, d’Éliane Patriarca, revient sur les événements historiques qui ont inspiré le film et qui demeurent, soixante quatorze ans après les faits, méconnus en France.
Les faits : le 25 juin 1943, Mussolini est destitué de ses fonctions de chef du gouvernement. Le maréchal Badoglio prend les pleins pouvoirs militaires sous l’autorité du roi Victor-Emmanuel. L’Italie, éprouvée par les années de fascisme et de guerre, est coupée en deux. Après son débarquement à Naples, le haut commandement allié cherche à s’ouvrir une voie vers Rome. La ligne de défense allemande – la ligne Gustav – traverse la Ciociaria, une région au sud de Rome, avec en son centre la ville de Cassino, dominée par une abbaye. Pendant de longs mois, l’offensive alliée s’enlise en tentant d’enfoncer cette ligne dont les Allemands demeurent inexpugnables. Le 11 mai 1944, au prix de la terrible bataille du Garigliano, la route de Rome s’ouvre enfin, victoire largement acquise grâce aux soldats du corps expéditionnaire français (CEF) sous l’autorité du maréchal Juin.
Pourtant, entre le 15 mai 1944 et le début du mois de juillet, les Italiens, croyant accueillir les « libérateurs », subissent un déferlement de violence d’une brutalité inouïe : des milliers de viols (12 000 selon les chiffres de l’organisation « Unione Donne italiane » en 1946 [p. 193]) sont commis sur des hommes, des femmes et des enfants par les soldats du CEF. La scène-clé du film de Vittorio de Sica montre précisément Cesira, la « Ciociara » (femme originaire de la Ciociaria), de retour dans sa ville natale après avoir fui les bombardements allemands sur Rome, tomber avec sa fille Rosetta sous les assauts d’un groupe de soldats. Si la scène ne dit pas explicitement qu’ils appartiennent au CEF (pour éviter la polémique et l’interdiction de son film, de Sica choisit de rester flou ; Sophia Loren s’adresse aux soldats français qu’elle croise après la scène du viol en ces termes : « savez vous ce qu’ont fait ces Turcs que vous commandez ? »), leur tenue en révèle l’origine. Vêtus de djellabas, coiffés de turbans, l’œil noirci à outrance au khôl, ils sont ceux que les paysans qui n’ont jamais quitté leur village ont désigné par le terme générique de « marocchini » : les marocains. C’est ce même terme qui donnera naissance à un terrible néologisme pour qualifier les exactions commises au printemps 1944 : les « marocchinate ».
Ancré dans les mémoires en Italie, plus spécialement dans la région de la Ciociaria, source de travaux et de récits, cet épisode de la campagne d’Italie n’a jamais été officiellement reconnu par la France. Il n’a d’ailleurs, et il suffit de consulter la bibliographie du livre d’Éliane Patriarca ou les catalogues des bibliothèques pour s’en assurer, fait que très récemment l’objet de recherches et de travaux. C’est une thèse menée par Julie Le Gac sous la direction d’Olivier Wieviorka (Vaincre sans gloire. Le corps expéditionnaire français en Italie, novembre 1942-juillet 1944 [Les Belles Lettres/Ministère de la Défense-DMPA, 2014]) qui évoque pour la première fois les violences sexuelles attribuées au CEF. Deux ans plus tard, 15 mai 2015, le journal Libération publie un article intitulé « Elle avait 17 ans et a été violée par 40 soldats » dans lequel Leïla Minano, envoyée spéciale dans le Latium, donne la parole aux derniers témoins.
Cette même année, en 2015, Éliane Patriarca, née en France d’une famille originaire de la Ciociaria, décide « de lever le voile de l’oubli et de l’ignorance » (p. 19) sur ces événements dont elle n’avait pas connaissance jusqu’en 2004, date de sa visite à l’abbaye de Monte Cassino. C’est en tant que journaliste, notamment à Libération, et parce qu’intimement liée à l’histoire de cette région, qu’elle veut « s’interroger sur les va-et-vient de la mémoire collective, familiale, sur la sélectivité de l’histoire officielle » (p. 18), mesurant à quel point « le souvenir de ce printemps 1944 et de la campagne d’Italie diffère selon que l’on vit d’un côté ou de l’autre de la frontière transalpine » (p. 99). Son propos est de comprendre et d’aller à la rencontre d’un « récit oublié » (p. 81)
Si, en 1946, les autorités françaises acceptent d’indemniser les dommages causés par ses troupes – « vols, saccages, meurtres mais aussi viols » (p. 100) – (le maximum accordé étant de 150 000 lires, soit le prix d’une vache), elles délèguent très vite cette responsabilité à une société italienne spécialisée dans le règlement des dommages de guerre. Mais le traité de paix de 1947, jugeant l’Italie responsable du conflit, l’oblige à verser des milliards de lires à la France et à renoncer à « toute réclamation de quelque nature que ce soit résultant directement de la guerre » (Ripa). Il faudra des années et la persévérance des associations pour que les victimes soient considérées comme telles et indemnisées.
En 2004, le gouvernement italien reconnaît officiellement les violences perpétrées par les troupes coloniales françaises sur la population d’un pays cobelligérant. « Nous regrettons de ne pas avoir d’éléments de réponse à vous transmettre sur ce dossier » (p. 212) déclarent les services du ministère des Affaires étrangères à Éliane Patriarca en juillet 2016 lorsqu’elle demande comment Paris a réagi à cette reconnaissance. Aujourd’hui, la justice concernant les viols du printemps 1944 n’est plus une priorité en Italie. Pourquoi la France s’embarrasserait-elle alors de ce « vieux dossier, politiquement délicat, au risque d’attiser les relents islamophobes ? » (p. 212) Car le terme de « marocchinate » n’est pas sans poser question en ce sens qu’il véhicule une vision aussi violente que caricaturale des troupes coloniales françaises.
Dans le numéro 39 (2014) de la revue Clio, dont le thème est Femmes, Genre, Histoire, la critique de Yannick Ripa au sujet de la thèse de Julie le Gac apporte des éléments intéressants quant au CEF : « pour la première fois depuis la défaite de 1940, le drapeau tricolore se déploie en Europe sur un terrain militaire, réinsérant la France républicaine dans le camp des nations en lutte contre les totalitarismes. Il est brandi par le Corps expéditionnaire français, sous le commandement du général Juin. L’absence d’un véritable vivier de recrutement en Afrique, où il est créé en novembre 1942, a conduit à un assemblage maigre et hétéroclite de soldats, que les autorités espèrent souder par une commune lutte […]. Se retrouvent ainsi des membres des Forces françaises libres, d’anciens cadres de Vichy […], des évadés politiques de l’Espagne franquiste, des Français des colonies et des “indigènes” de l’Empire, dont la motivation première est d’ordre financier. Julie Le Gac montre habilement que cette volonté de cohésion cache, outre bien des dissensions, les préjugés des autorités militaires sur la définition normative de la virilité, blanche s’entend. Malgré leur indéniable valeur dans l’ “âpre et destructive guerre de position”, les “goumiers” demeurent à leurs yeux des soldats imparfaits qui, comme tels, ne sauraient se substituer aux Européens. […] Néanmoins, la dureté et la durée de la bataille de Monte Cassino fissurent la cohésion du CEF et son unité patriotique : les “corps à corps silencieux et assassins” dissolvent le sens idéologique de la lutte, le transforment en sacrifice absurde aux yeux de ceux qui se battent pour des principes dont ils sont eux-mêmes exclus. Ce désenchantement participe-t-il des exactions qui ternissent l’action du CEF ? Julie Le Gac n’établit pas ce lien, mais indique combien les représentations de la virilité des indigènes permirent aisément de leur attribuer les violences sexuelles qui accompagnèrent la victoire finale. Ces forces du CEF sont accusées à la fin de mai 1944 d’avoir agi en “barbares” à l’égard des civils sans défense, ce dont témoigne le personnel médical des centres de réfugiés. » (Ripa)
Lorsqu’en 2006, en France, le film Indigènes reconnaît l’aide apportée au combat par les troupes coloniales françaises dans le conflit – aboutissant à la revalorisation des pensions attribuées aux anciens combattants coloniaux –, le souvenir des événements du printemps 1944 resurgit en Italie, aussitôt récupéré par l’extrême droite, friande de fantasmes et de caricatures, qui va jusqu’à détourner l’affiche du film. Les associations de victimes, elles, tentent d’échapper à une instrumentalisation politique qui éclipse « les responsabilités du fascisme dans la chaîne de souffrance de l’Italie » (p. 146) et qui, selon l’une des sources d’Éliane Patriarca, Giuseppe Moretti, le maire de la ville d’Esperia – dont 90 % de la population a été victime de viols en 1944 –, a « rendu impossible l’inscription dans les livres d’histoire, et dans la mémoire collective nationale, des marocchinate » (p. 146).
Reconnaîtra-t-on un jour ces viols de masse comme un crime contre l’Humanité ? « On dispose de tous les éléments pour lancer une action en justice contre la France » (p. 215) déclare à Éliane Patriarca Fabrizio Battistelli, sociologue italien enseignant à l’université de la Sapienza à Rome. La France et l’Italie confronteront-elles un jour leur expérience du passé ?
S’appuyant sur ses rencontres avec les associations locales, des historiens et des chercheurs italiens, sur des archives, des récits et des témoignages recueillis dès 1944 par la police et la justice, Eliane Petriarca ne prétend ni révéler ni dénoncer, mais combler un vide. Mêlant récit personnel et enquête, ne cachant rien de l’émotion que suscite en elle ce retour aux origines, elle porte ainsi à la connaissance des lecteurs français, et de manière très personnelle, une page encore aujourd’hui polémique, de la « libération » de l’Italie.
Œuvres citées
Référence papier : Yannick Ripa, 2014, « Julie Le Gac, Vaincre sans gloire. Le Corps expéditionnaire fran.ais en Italie (novembre 1942-juillet 1944) », Clio, Femmes, Genre, Histoire, n° 39, p. 294-296.
Référence électronique : Yannick Ripa, 2014, « Julie Le Gac, Vaincre sans gloire. Le Corps expéditionnaire fran.ais en Italie (novembre 1942-juillet 1944) », Clio. Femmes, Genre, Histoire [en ligne], n° 39, mis en ligne le 1er juin 2014, consulté le 18 avril 2018. URL : http://journals.openedition.org/clio/11966
