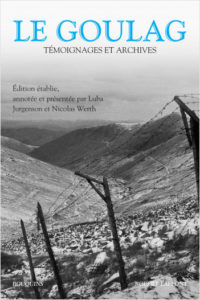Édition établie, annotée et présentée par Luba Jurgenson & Nicolas Werth
Paris, Robert Laffont (coll. « Bouquins »)
2017, 1 120 p.
On croit avoir une idée du Goulag quand on a lu Chalamov, Soljenitsyne et quelques autres. Et il est vrai que, longtemps, la seule source était les témoignages des survivants. L’ouverture des archives soviétiques en 1990 a changé la donne, en rendant accessibles nombre de textes officiels. L’ouvrage monumental de Luba Jurgenson et Nicolas Werth procède à un montage entre des témoignages, certains connus, la plupart non – même quand ils ont été publiés –, et des textes administratifs, où la langue de bois cède parfois la place à de terrifiants aveux.
L’organisation du livre est à la fois chronologique et thématique, et ses apports factuels se situent à plusieurs niveaux. Géographique d’abord : la diffusion du Goulag sur tout le territoire, mais aussi le fait qu’il s’agit d’une réalité en mouvement : les camps sont mobiles, mobiles aussi les détenus, selon qu’ils sont « déplacés spéciaux », « colons de travail » ou déportés ethniques. Si les chapitres jalonnent les étapes de la déportation, de l’arrestation jusqu’au « retour » des amnistiés ou libérés, ils marquent aussi l’évolution historique et politique, les tournants du Goulag : on ne peut pas comparer le premier camp des Solovki, où les « politiques » avaient encore quelques droits, avec les « mouroirs » de la Grande Terreur (1937-1939). De même, sont mis en lumière les changements de « cibles » : les « politiques », les « contre-révolutionnaires », mais aussi certaines nationalités (Baltes, Roumains, Polonais…) ou ethnies (Tchétchènes, Tatars…).
Quels étaient les objectifs du Goulag ? En 1919, Dzerjinski écrit que les camps « n’ont rien à voir avec les prisons, ni avec les bagnes capitalistes. Ce sont des écoles de travail visant à rééduquer les criminels » (p. 653). Mais l’objectif économique est présent d’emblée : il s’agit d’exploiter des régions inhospitalières mais riches en minerais divers, où un travailleur libre ne songerait pas spontanément à s’établir. Le NKVD (Commissariat du peuple à l’Intérieur) est le principal producteur d’or, de platine, d’argent, de diamants, de nickel, de radium et d’amiante du pays, et il contribue aux grands travaux d’infrastructure. Les auteurs estiment néanmoins que « la fonction politique de répression a toujours primé sur les logiques économiques du travail forcé » (p. 25).
L’exemple le plus connu de la politique de grands travaux est la construction du canal Baltique-mer Blanche, si coûteuse en vies humaines. Les détenus sont des « combattants du canal », d’où le terme de ze-ka ou zek qui en vient à désigner tout déporté. Le Belbaltlag est documenté par des milliers de photos, prises de façon officielle par Alexandre Boulla, célèbre photographe arrêté en 1929. « Cette promotion de l’entreprise concentrationnaire semble aller à l’encontre de notre représentation des violences d’État que nous savons évincées hors de l’espace du visible. » (p. 655) C’est, en effet, le contraire des images malgré tout dérobées à l’anéantissement nazi. Il s’agissait bien de promouvoir l’entreprise, comme devait le prouver l’ouvrage collectif réalisé par trente-six écrivains sous la direction de Gorki, publié en 1934, mais retiré de la circulation quelques années après, plusieurs auteurs ayant été démasqués comme « ennemis du peuple ». Autre exemple de « promotion », il y eut en 1944 un concours pour « le meilleur camp et la meilleure colonie de travail correctif de l’URSS » (p. 659).
Mais l’occultation est de mise pour d’autres réalités, comme les « déportations-abandons » des années 1920, ou les terribles famines de 1930-1933. Julius Margolin peut écrire avec ironie : le Goulag représente « le plus grand complexe industriel de l’histoire mondiale […] Il est bien dommage […] que le gouvernement, qui pourtant met en avant les records de la “construction socialiste”, garde le secret en ce qui concerne ces institutions » (p. 317).
Ces objectifs économiques étaient-ils remplis ? La mortalité est telle que les rapports dénoncent, non pas l’inhumanité de cette exploitation, mais son inefficacité. Si le contraste est évident entre les témoignages et les textes officiels, ces derniers eux-mêmes sont travaillés par des contradictions. À côté des discours de parade, dont Gorki donne un consternant exemple, on est surpris de trouver, dans certaines circulaires, un réel souci du bien-être des détenus : certes, il s’agissait là d’avoir une main-d’œuvre à peu près opérationnelle et pas des morts de faim ou d’épuisement. Mais ce n’est pas de main-d’œuvre que témoigne la lettre d’un officier de santé de la région d’Omsk, qui supplie qu’on lui envoie « ne serait-ce que du sucre et un peu de semoule » pour les « enfants de koulaks » en train de mourir de faim (p. 509).
Parmi les textes officiels qui documentent sans fard la vie du Goulag, une évolution se repère. Un premier rapport, en 1930, estime que 25 à 35 % des déportés l’ont été à tort, dénonce l’énorme morbidité et mortalité infantile, propose des solutions : mais l’auteur était un proche de Boukharine, et une opposition existait encore. Plus tard, on est surpris de lire sous la plume de Vychinski (oui, Vychinski, le procureur des procès de Moscou) que les « conditions de détention [sont] mauvaises et dans certains cas absolument insupportables » (p. 754), cela en 1938. La même année, Iejov fait le même constat, et sa solution est de déférer les responsables devant un tribunal militaire. En 1941, une note du chef du Goulag constate qu’« aucune mesure [n’a été] prise pour améliorer les conditions de vie des détenus » (p. 763). Pourtant, le camp devrait être une « guillotine à rendement », selon l’expression de Lev Razgon (p. 390), ce qui aboutit entre autres à une contradiction qui ferait sourire si on en avait envie : les « politiques » sont en principe exclus des tâches de « spécialistes », mais parmi les « socialement proches » (sic), c’est-à-dire la pègre, il n’y a pas de médecins, d’ingénieurs, ni d’économistes… Autre contradiction, signalée en 1952 par une note officielle mais confidentielle : la criminalité a fâcheusement diminué, ce qui fait que les besoins en main-d’œuvre ne sont pas couverts – et qu’on en arrive à maintenir sur place les détenus libérés. Les auteurs posent, comme en passant, une question qui n’est pas dénuée de pertinence : peut-on comparer le Goulag à l’exploitation des colonies par les pays occidentaux ?
Après la guerre, la machine bureaucratique du Goulag s’est encore alourdie, la productivité du travail pénal est faible. En 1953, peu après la mort de Staline, une amnistie libère en quelques mois plus d’un million de détenus, et stoppe plusieurs grands chantiers. L’arrestation de Beria est suivie d’une vague d’émeutes, de grèves et de révoltes ; de ce fait, en trois ans (1954-1957), le nombre de « politiques » au Goulag diminue de 97 %. Conséquence inattendue : « brisées par la force, les grandes révoltes des détenus de 1953-54 ont pesé lourd dans l’accélération du “dégel” khrouchtchévien » (p. 905).
Le camp, « microcosme social », regroupe les catégories sociales les plus diverses, mais mélange délibérément les « politiques » et la pègre : les droits communs jouent un rôle analogue à celui des kapos des camps nazis. Une circulaire de 1949, dénonçant « la légalisation des éléments criminels dans les camps » (p. 463), démontre involontairement la diffusion de cette pratique.
Les autorités, par des transferts fréquents, en séparant les communautés, s’efforcent d’interdire tout rassemblement qui les menacerait. Nombre de récits décrivent des situations de désorientation, d’inadaptation, une désocialisation radicale. Pourtant, il existe des formes de résistance, la plus modeste étant peut-être la « lettre à Staline », attestée tout au long de l’existence du Goulag. En 1929, Staline exaspéré écrit que l’OGPOU n’est pas « une boîte postale au service des vils chiens petits-bourgeois de la contre-révolution » (p. 829) ! Plus réaliste, Julius Margolin écrit à Ilya Ehrenbourg qui, sans surprise, ne répondra pas… mais la lettre aura quelques effets bénéfiques.
Autres signes de résistance, en gradation : la grève de la faim, l’évasion et l’émeute. Il faut noter ici l’absence de transmission politique : inculpés pour des crimes imaginaires, les détenus « 58 » n’étaient en général pas vraiment engagés, les militants des partis d’opposition avaient été tués, étaient morts dans un camp, ou trop âgés. Ce n’est qu’après la mort de Staline que des révoltes, avec l’expérience d’une action collective, renouent avec des réflexes politiques oubliés. Les révoltes sont durement réprimées, mais le mouvement de « libération » des camps se poursuit. Cependant, les libérés sont confrontés à de multiples difficultés : pour trouver du travail, un logement, récupérer les biens confisqués, retrouver leur famille… Sont-ils vraiment libérés ? La femme qui épouse un ancien détenu réhabilité est exclue du parti et virée de son travail.
La féconde juxtaposition de documents et de récits ouvre sur une réflexion théorique sur le statut de ces récits. « Nous, les survivants, ne sommes pas les vrais témoins » : cette phrase de Primo Levi condamne tendanciellement tout témoignage, puisque ceux qui témoignent, par définition, ont survécu. Seul le « crevard » (dokhodiaga), analogue aux « musulmans » des camps nazis, peut témoigner : « Le dokhodiaga est donc ce “témoin intégral” qui, selon Primo Levi, serait le seul légitime, cependant disparu ou muet. Dans les camps soviétiques, il peut revenir d’entre les morts… » (p. 578), cela en bénéficiant d’une tâche plus légère, d’un chef compatissant, d’un peu plus de nourriture.
On ne s’étonnera pas d’apprendre que la Russie actuelle n’a pas de politique mémorielle officielle sur le sujet ; le relais est pris par des associations comme Memorial, créée en 1989. L’implosion de l’URSS a suscité de nouveaux témoignages, tardifs, mais leur intérêt n’est pas moindre.
Sont-ils fiables ? Certains témoins se trompent, par exemple, dans leur estimation du nombre de détenus et de morts, ce qui n’invalide pas leur propos. D’autres rapportent des faits qu’ils n’ont pas connus directement, c’est le cas de Soljenitsyne ou de Chalamov, mais ils relaient des faits avérés par d’autres. En cela, leurs textes sont une sorte de création collective, où des faits identiques ou analogues se font écho. Il peut leur arriver de « fictionnaliser » leur récit, mais ces éléments de fiction eux-mêmes sont porteurs d’information : « outre la dimension heuristique de l’erreur, ils révèlent que certaines situations apparaissent à celui qui les vit comme fantastiques… » (p. 30). Autre élément de fictionnalisation possible, l’impossibilité, pour les détenus ayant pris part aux révoltes, de « s’identifier à la figure de la victime non violente qui crée le cadre de référence pour la majorité des témoins » (p. 833). C’est ainsi que le récit de Chalamov, Le Dernier Combat du commandant Pougatchev, « vient combler une place manquante dans le schéma actantiel du GOULAG, où la figure du résistant est peu présente » et « nous rappelle que l’imaginaire peut être en soi un espace de résistance » (ibid.). Enfin, pour tous, même les moins cultivés, écrire est un laboratoire d’expérimentation littéraire. Chalamov, en privilégiant la forme-fragment, rejoint les recherches des avant-gardes poétiques ; et il donne à ses personnages des noms d’écrivains et de héros littéraires, « suggérant par là que la littérature russe a été placée en détention » (p. 89).
Ce qu’ils apportent dans tous les cas, c’est une réflexion sur l’expérience des limites. « La violence extrême, en détruisant les cadres cognitifs de la perception, met en échec le récit. […] Les écrits des témoins contribuent à rendre cette expérience intelligible » (p. 74). La tentation a été grande, pour certains, peut-être pour tous, d’oublier, de tourner la page, et nous ne savons pas combien d’entre eux y ont cédé : mais ceux dont nous lisons les récits ont réussi à résister à cette « injonction d’oubli ». Ils ne se contentent pas de laisser une trace documentaire de leur histoire, ils en proposent une interprétation et parfois accèdent à ce que les auteurs appellent un niveau « méta-mémoriel » (p. 92), où c’est la mémoire elle-même qui est interrogée.
Le livre démontre avec précision que le Goulag obéissait à des impératifs à la fois économiques et politiques. Mais lorsque les détenus du Gorlag (Norilsk) s’adressent au gouvernement soviétique, soulignant que « les réalisations grandioses du socialisme sont le fruit de nos efforts, nous les forçats des camps de travail » (p. 904), est-ce seulement de l’ironie, ou de l’opportunisme ? Dans tous les textes qui affirment leur foi dans l’idéal communiste, faut-il ne voir qu’illusion, dénégation d’une réalité trop difficile à admettre, « besoin de sauver l’ensemble de l’édifice idéologique » (p. 103, n. 1) ?
Impossible de donner ici une idée complète de la richesse à la fois factuelle et théorique de cet ouvrage. On peut seulement en recommander très vivement la lecture.
Publié dans Mémoires en jeu, n°6, mai 2018, p. 143-145.