Le Journal de Rywka Lipszyc. Témoignage du ghetto de Łódź (octobre 1943-avril 1944)
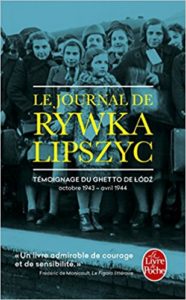 Traduit du polonais par Kamil Barbarski, appareil critique traduit de l’anglais (États-Unis) par Agnès Blondel ; suivi d’un dossier pédagogique sur les Juifs de Pologne, des premières communautés à aujourd’hui par Audrey Kichelewski. Paris, Librairie générale française, 2016, 352 p.
Traduit du polonais par Kamil Barbarski, appareil critique traduit de l’anglais (États-Unis) par Agnès Blondel ; suivi d’un dossier pédagogique sur les Juifs de Pologne, des premières communautés à aujourd’hui par Audrey Kichelewski. Paris, Librairie générale française, 2016, 352 p.
&
À travers les yeux d’une fille de douze ans
Janina Hescheles
 Édition de Judith Lyon-Caen et Livia Parnes, traduit du polonais par Agnieszka Żuk, Paris, Classiques Garnier, 2016, 130 p.
Édition de Judith Lyon-Caen et Livia Parnes, traduit du polonais par Agnieszka Żuk, Paris, Classiques Garnier, 2016, 130 p.
Ces deux témoignages de jeunes filles ayant vécu et écrit pendant la Shoah sont tout à fait exceptionnels, et ce pour plusieurs raisons. Rywka Lipszyc a grandi dans le ghetto de Łódź. Le seul volume du journal qui nous reste (on verra plus tard son incroyable itinéraire) a été écrit lorsqu’elle avait quatorze ans. Quand elle le commence, le 3 octobre 1943, elle vit dans le ghetto depuis trois ans, son père est mort en 1941 après avoir été sauvagement battu par les Allemands, sa mère qui s’est occupée de ses quatre enfants est morte un an plus tard de malnutrition et d’épuisement. Les deux sœurs Lipszyc vont être hébergées par les membres de la famille encore en vie. C’est alors qu’elles subissent, comme tous les autres Juifs, l’énorme choc de la « szpera » (couvre-feu) de septembre 1942, lorsque les autorités allemandes exigent de Chaim Rumkowski, « Doyen des Juifs », de leur livrer 15 000 Juifs de moins de dix ans ou de plus de soixante-cinq ans. C’est ainsi que, des six membres de la famille, ne vont rester que Rywka et sa soeur Cipka.
La jeune fille rapporte ce souvenir dans son style caractéristique : « … ah, je suis exténuée déjà… J’ai des remords parce qu’on a déporté Abramek et Tamara, oh, mon Dieu ! Rends-les-moi maintenant, je n’y tiens plus, mon cœur va se briser… Abramek, où es-tu ? Tamara ! Oh, je n’en peux plus ! Des forces, ah… Et les sanglots m’oppressent… Et je suis comme pétrifiée, je n’arrive même plus à pleurer … » (15.01.1944). Cette emphase frisant la mièvrerie, ce ton pathétique, ces oh et ah fréquents n’étonnent pas vu les circonstances et l’âge de l’écrivaine. Cela souligne les émois de Rywka, la solennité de ses propos l’aide sans doute à vaincre son désarroi, son désespoir : « … C’est vraiment terrible… Terrible… Terrible… Tragique… Oh, tragédie ! N’est-ce pas assez ? Est-ce la dernière. Dieu seul le sait ! Mais… je dois me dire : garde la tête haute ! Et ma tête retombe si étrangement… Que faire pour la lever ? Je ne sais pas ! Ah, quelle amertume ! Que c’est amer ! Oh, je voudrais faire couler tout mon chagrin sur le papier, ça irait peut-être mieux ? Ah, quoi encore ? » (15.02.1944). Étrangement, quand il s’agit des faits quotidiens (école, travail, bain, nourriture ou plutôt son manque, et donc la faim, le froid omniprésent…), Rywka devient très « terre à terre », s’exprime d’une façon simple, réaliste, sans excitation. Le pathos revient en revanche dans les lettres à une amie, Surcia, qui visiblement prend beaucoup d’importance dans l’existence de Rywka : « Surcia, mon adorée ! Que t’écrire de plus, sinon que j’ai déjà tant à te dire et, quand nous nous verrons, je ne saurai par où commencer, ah, Surcia… » (16.02.1944). À propos de telles envolées lyriques, Alexandra Zapruder remarque dans sa préface : « on a l’impression de lire une adolescente folle d’amour pour Surcia » (p. 39). Cependant, le journal ne porte pas explicitement trace d’émois amoureux. Bien qu’elle confesse : « Oui, j’aime Surcia ! » (2.02.1944), l’érotisme propre à son âge y est étrangement absent.
Rywka se confie et se fie totalement à Dieu. La religion occupe une grande place dans sa vie, la fait tenir, la console : « Comme j’aime Dieu ! Je peux me reposer sur Lui toujours et partout […]… je sais que Dieu m’aidera ! Oh, comme c’est bien que je sois juive et comme c’est bien qu’on m’ait appris à chérir Dieu… Je suis reconnaissante pour tout cela ! Merci, mon Dieu. » (2.02.1944). Inutile donc de chercher un quelconque signe de révolte chez Rywka, malgré l’immense chagrin qu’elle éprouve de la perte des siens, malgré le récit terrifiant de ce qui se passe dans le ghetto.
Nous pouvons lire ces pages en historien, pour apprendre la réalité du quotidien du ghetto de Łódź. D’ailleurs, Audrey Kichelewsky nous sert de guide lors de cette visite d’antichambre de l’enfer. Dans son excellent dossier pédagogique, composé de précisions sur l’histoire des Juifs de Pologne, sur la ville de Łódź et sur son ghetto, on retrouve des détails concernant l’organisation de la vie au sein du ghetto (notamment la mise au travail de l’intégralité de la population dans une centaine d’usines et d’ateliers destinés à la production de biens pour les Allemands, mais également des biens de consommation courante destinés à la population « aryenne » de la ville, p. 293), les ordres successifs allemands limitant les possibilités de survie, la famine qui emporte de plus en plus de victimes…
La dernière partie de cette publication est proprement fascinante : il s’agit du chapitre « Qu’est-il arrivé à Rywka Lipszyc ? » écrit par Judy Janec, ancienne directrice de la bibliothèque et des archives de la Tauber Holocaust Library du Jewish Family and Children’s Services (JFCS) Holocaust Center (p. 345-359). Car le journal s’arrête le 12.04.1944, la phrase est coupée au milieu, restée inachevée (et prend donc ici toute sa dimension et sa teneur symboliques) pour des raisons que l’on ignore, puisque Rywka survit à la dernière vague de déportations (plus de 7 000 Juifs envoyés à Chełmno entre le 23.06 et le 14.07.1944). Lorsque l’Armée rouge pénètre dans la ville le 19.01.1945, seuls 877 Juifs y vivent encore, apprend-on dans le dossier pédagogique. Rywka est déportée à Auschwitz, pas gazée à son arrivée (elle va donc vivre encore un peu), survit aux « marches de la mort », arrive à Bergen-Belsen, et décède probablement peu après.
Probablement… Judy Janec veut en avoir le cœur net et, toutes proportions gardées, on lit son récit sur les traces de Rywka après sa libération à Bergen-Belsen comme un roman policier. Les faits sont les suivants : au printemps 1945, pendant la Libération, Zinaida Berezovskaya, médecin de l’Armée rouge, exhume les feuilles d’un cahier qui s’avéreront plus tard être le journal de Rywka. Elles sont étonnamment bien conservées. Elle emporte le journal chez elle, à Omsk, en Sibérie, où elle meurt en 1983. Ses affaires sont envoyées à son fils qui vit à Moscou. À sa mort, sa petite-fille trouve le journal en 1995, l’emporte avec elle en émigrant à San Francisco. Cherche désespérément vers qui se tourner pour le faire connaître, en parle finalement à Judy Janec. Grâce à l’énergie de plusieurs personnes, le journal sort en anglais en 2011. Janec continue ses recherches pour savoir comment et où exactement est morte Rywka. Au bout de plusieurs années de quête et d’enquêtes, elle apprend seulement que des cousines de Rywka lui ont rendu visite à l’hôpital de Bergen-Belsen où, d’après l’avis des médecins, elle n’avait plus que quelques jours à vivre. Mais pas de trace de document attestant le décès de Rywka à l’hôpital de Niendorf où ont été transportés les malades du camp, aucune tombe, alors que d’autres anciens détenus de Bergen-Belsen en ont une . (« Jusqu’à preuve du contraire, il restait encore l’espoir qu’elle ait survécu jusqu’à un âge avancé », écrit Judy Janec, p. 349). Elle cherche à Łódź, à Auschwitz et Bergen-Belsen, à Lübeck, à Londres… « Après des années de recherche, et malgré les efforts joints d’archivistes et d’historiens du monde entier, le mystère reste entier. Mais il y a toujours de nouvelles pistes à explorer. Nous continuerons notre enquête sur cette jeune rescapée, en espérant qu’un jour nous saurons ce qui est arrivé à Rywka Lipszyc », écrit Judy Janec (p. 358), indiquant pour finir ses coordonnées au cas où quelqu’un aurait des informations à lui transmettre.
Il y a quelque chose de noble et de pathétique dans cette missive. Volonté de comprendre à tout prix « quelque chose » à cette mort individuelle faute de pouvoir comprendre ce meurtre-là, ce crime-là, cette monstruosité collective ?
Le journal de Janina Hescheles est de tout autre nature, à commencer par le fait qu’il a été écrit « après coup ». En effet, Janina s’évade en 1943 à l’âge de douze ans du camp de la rue Janowska à Lvov. L’évasion est rendue possible grâce à l’intervention des membres du réseau polonais d’aide aux Juifs, Żegota, et l’implication personnelle de Michel Borwicz. Il s’agit donc, non pas du journal tenu au jour le jour, mais des souvenirs que Janina rédige depuis sa cachette à Cracovie. La perspective n’est pas la même. Certes, Janina garde bien en mémoire tout le cauchemar du camp mais ce n’est pas un écrit in statu nascendi, même si l’extermination est encore en train de se dérouler.
Judith Lyon-Caen, dans sa très complète introduction à l’ouvrage (qui est en fait un véritable essai), s’arrête sur toutes les particularités de ce texte. Tout d’abord, il faut avoir à l’esprit que le témoignage de Janina porte sur la vie à Lvov entre 1941 et 1943, et ce sont des informations d’une valeur historique inestimable sur cette période et ce territoire-là : premiers mois de l’occupation allemande (06.1941, après celle des Soviétiques 09.1939), le ghetto, le camp Janowski (où elle assiste tous les jours en rentrant du travail à l’exécution des enfants et des adultes). Elle vit des choses horribles, notamment la mort de son père, sorti des geôles soviétiques, lors du pogrom (il la laisse avec cette phrase sibylline : « Pleurer n’est qu’une humiliation dans le malheur, comme dans le bonheur »), le suicide de sa mère… Le ton de ce document est à l’opposé de celui de Rywka : sec, précis, une mise au fait détaillée mais sans états d’âme. Ce n’est pas en Dieu que Janina cherche la consolation, elle entretient des liens plutôt lâches avec la religion :
Le jeûne c’était en rapport avec la religion, en souvenir de la souffrance des Juifs sous le joug égyptien. Mais moi aussi, j’étais juive. Je ne voulais pas y penser davantage. Je sentais que sinon, j’allais de nouveau arrêter de croire en Dieu, alors que la foi, c’était l’espoir. J’ai décidé de jeûner. […] Au lieu de pleurer ou prier, je me suis de nouveau mise à douter.
Pourquoi ce jeûne ? Après tout, y a-t-il un Dieu ? Et de nouveau j’ai arrêté de croire. […] Je me suis réveillée à quatre heures et avec Ala, nous avons mangé nos tranches de pain avec de la saucisse. J’étais la seule dans le baraquement à rompre le jeûne… Rassasiée, je suis retournée dans mon lit avec délice, et j’ai dormi jusqu’au matin. » (p. 93, 95)
C’est en quelque sorte la littérature qui a sauvé la vie à Janina. Elle présente ses poèmes (certains sont inclus dans le livre) à Michal Borwicz, son futur sauveur, dans le cadre des activités clandestines de celui-ci. Voici ce que Borwicz en dit dans son ouvrage Literatura w obozie [Littérature dans le camp, Cracovie, 1946] :
Elle n’avait rien d’arrogant et n’était pas du tout maniérée. Elle était simple, réfléchie et un peu sombre. Ses poésies étaient primitives (dans le bon sens de ce mot). La manière dont elle les déclamait, naturelle et sans affectation, faisait grande impression. J’ai décidé de faire un cadeau à cette enfant… Janina a eu son livre… Le livre était très abîmé, sans couverture, et si je me souviens bien, il lui manquait quelques pages, mais il était là – ce volume de poésies de Mickiewicz. Tel était le cadeau que je fis à cette enfant pour son alliance avec la littérature. » (p. 24 de l’introduction).
Ces propos de Borwicz, écrivain, futur historien et critique de la poésie de la Shoah, « habitant » du ghetto de Lvov, détenu à Janowska lui-même, sont proprement extraordinaires. Pour le cas de la Pologne, cette « alliance avec la littérature » est une chose sacrée si l’on se rappelle le rôle de la littérature pendant le XIXe siècle notamment, où, faute d’instances étatiques, la poésie romantique (avec Adam Mickiewicz, poète prophète, en tête) endossait la mission de sauvegarde de la substance nationale.
Le texte de Janina tel qu’il est présenté dans cette édition est une création, il résulte des opérations éditoriales effectuées par Maria Hochberg-Mariańska et Michel Borwicz sur les cahiers de Janina en 1946. En effet, il y a eu deux récits, l’un sur le camp, l’autre qui allait de l’été 1941 jusqu’à l’évasion.
Comme nous l’apprenons dans l’introduction, en 1946, on a décidé de réunir ces deux récits en un seul, linéaire et chronologique. On a également procédé à de multiples corrections et à des modifications, et surtout fondu le premier récit dans le second, de sorte qu’en 1956 Janina Hescheles écrit à Borwicz qu’elle ne se reconnaît pas dans son texte. Les interventions réalisées par les éditeurs sur le manuscrit de 1943 sont signalées dans la présente édition, en restituant à Janina sa véritable voix. Elle écrit dans le très bel Épilogue, à Haïfa, en 2015 : « […] aujourd’hui “mon’’ Lvov se trouve partout où on déstabilise la vie, où les gens perdent leur famille, où on les chasse de leurs villes et de leurs villages natals » (p. 105).
On ne sort pas indemne de la lecture de ces deux témoignages de jeunes filles qui ont vécu dans ces temps lugubres où la plus douce caresse, la seule promesse et l’ultime consolation en guise d’adieu d’une mère envers son enfant était de lui cacher les yeux avec ses mains au moment de la fusillade.
Publié dans Mémoires en jeu, n°3, mai 2017, p. 140-143
