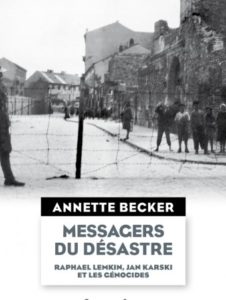 Annette Becker
Annette Becker
Paris, Fayard histoire, 2018, 287 p.
Dans un livre magistral, Annette Becker tisse l’histoire de deux hommes qui ne se rencontrèrent jamais mais partagèrent pourtant un destin commun : celui d’être les messagers de la Shoah à une époque où personne ou presque ne sut ou ne voulut comprendre la portée inédite d’un crime qui ne portait pas encore le nom de génocide. De la question « qui savait quoi ? » ou « qui niait quoi ? », ce livre déplace habilement l’attention sur le « pourquoi n’at- on pas pu croire ces messagers ? ». La réponse ne laisse pas d’être paradoxale : si l’univers mental hérité de la Première Guerre mondiale a bien constitué un obstacle majeur à la compréhension des événements conduisant à la destruction des Juifs d’Europe, il a été également la source de lucidité de ceux qui, très tôt, prirent conscience du caractère radicalement nouveau du crime perpétué. Il fallait bien une historienne des « mémoires et des refoulements de la Grande Guerre » (p. 13) pour réussir à mettre en perspective ce que les spécialistes de la seule Shoah ne pouvaient saisir.
Pour raconter cette histoire extraordinaire, Annette Becker fait feu de tout bois : les écrits contemporains et les témoignages ultérieurs des deux protagonistes, bien sûr, mais aussi de nombreux fonds d’archives consultés au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Israël, en Suisse, en France, confrontés aux très nombreuses pièces laissées par des personnes impliquées dans les péripéties de Lemkin et Karski ou plus généralement, par des témoins directs et indirects de la catastrophe en cours. La diversité des sources en dit long sur l’ambition de cette étude véritablement transnationale qui s’emploie à tracer la circulation des informations de part et d’autre de l’Atlantique avec une grande dextérité. Le lecteur se laisse volontiers guider sans jamais se perdre dans les méandres d’une histoire forcément complexe, emporté par la force d’une démonstration érudite mais toujours dynamique. Car c’était un défi d’écriture que de mener de front ces deux histoires qui finissent par n’en faire qu’une.
Un premier chapitre, relativement court, associe étroitement Raphaël Lemkin « le juriste » et Jan Karski « le combattant » en 1939. Puis le récit tresse habilement deux parcours de vie très différents : celui du juriste juif polonais d’un côté, qui choisit la route de l’exil ; celui du patriote et résistant catholique polonais de l’autre, qui mène son combat en Pologne. Ce qui frappe d’emblée chez nos deux protagonistes, c’est la précocité de la prise de conscience des enjeux de la politique hitlérienne, une acuité rare seulement partagée alors avec un Werfel ou un Doubrov. Si les travaux juridiques de Lemkin et son intérêt pour le massacre des Arméniens le prédisposent à prendre la mesure de ce qui se passe dès 1940, ce n’est pas le cas de Karski qui ne perçoit pas dans un premier temps la nature spécifique de la persécution des Juifs par rapport à celles que connaissent les Polonais, « deux peuples persécutés par le même ennemi », note-t-il en 1940 (p. 37). Mais très tôt, Karski met des mots sur les faits, particulièrement dans le fameux rapport remis à Roosevelt en décembre 1942 : il rencontre alors Schmul Zygelbojm, représentant juif au Conseil national polonais à Londres, qui transmet au Foreign Office, dès le printemps 1942, des preuves photographiques accablantes de ce que l’anéantissement des Juifs de Pologne n’est pas une atrocité de guerre parmi d’autres. Ce que le ministère commente d’un lacunaire « Aucune action ne semble nécessaire » : on est en septembre 1942 et, déjà, 60 % des habitants du ghetto de Varsovie ont été liquidés.
Ainsi, si Lemkin comprend l’unicité du crime en se fondant sur ce qu’il savait du cas arménien, Karski transmet aux autorités britanniques puis étatsuniennes une nouvelle déjà largement connue depuis l’été 1942. Mais la portée du message de Karski ne tient pas tant dans son contenu, pourtant plus détaillé que ce dont les Alliés disposaient alors, que de la nature du messager : un résistant catholique qui ne peut être taxé de judéophilie et qui en outre, a vu le ghetto de Varsovie puis le centre de transit d’Izbica (qu’il prend à tort pour le camp de Belzec). Ainsi, Karski est un témoin direct des méthodes d’extermination des Juifs de la région où vivait Lemkin, alors même que ce dernier attend 1945 pour connaître le sort de sa famille. Ces points de vue inversés que représentent finalement Lemkin et Karski ont pourtant une chose en commun : ils se heurtent à l’incrédulité de la majorité de leur auditoire.
C’est ici que le livre d’Annette Becker révèle toute sa force en contextualisant la Shoah dans cette guerre de trente ans qui plongea l’Europe dans les ténèbres. Car si les nouvelles provenant d’Europe convergent toutes pour souligner le caractère inédit de ce que souffrent les Juifs européens, les lecteurs sont loin d’être convaincus de la réalité présente car ils gardent le souvenir des « mensonges » concernant les atrocités allemandes commises en Belgique et dans le nord de la France lors du premier conflit mondial : la « fabrique de cadavres » et les mains coupées des enfants belges redeviennent un enjeu central en 1942. Ce sont sur ces doutes que Lemkin et Karski n’ont cessé de buter, tout comme le diplomate Varian Fry ou les écrivains George Orwell et Arthur Koestler. Il n’y a aucune raison de ne pas les croire et pourtant, toutes les raisons de ne pas le faire. Mais en même temps, c’est bien la connaissance de la guerre de 1914, et particulièrement du sort des Arméniens, qui permet à Lemkin de dessiner les contours juridiques de ce qu’il dénommera en 1943 le « crime de génocide », alors qu’il écrivait Axis Rule in Occupied Europe. Non pas « crime contre l’humanité » tel que les diplomates français, britanniques et étatsuniens ont qualifié le génocide arménien dès mai 1915, mais « crime de barbarie et de vandalisme », selon une formule élaborée dès 1933, qui vise la disparition d’un peuple de la surface de la terre.
En mars 1943, Haïm Weizmann, président de l’Organisation sioniste mondiale, écrit amèrement : « Le monde ne peut plus prétendre que ces faits horribles sont inconnus ou non confirmés. […] Nous sommes détruits par une conspiration du silence » (p. 139). Si bien que la rencontre de Karski et du président Roosevelt, en juillet 1943, ne fait que confirmer ce que chacun pressent : la question juive est un problème subalterne qui ne peut détourner les Alliés de leur unique but de guerre, la défaite du IIIe Reich. Au mieux, les Alliés promettent que justice sera faite. Il faut attendre encore six mois pour que soit fondé le War Refugee Board au sein de l’administration étatsunienne, bureau dont l’intitulé même élude sa principale raison d’existence, c’est-à-dire la déportation des Juifs européens. C’est que les « crieurs », ou les « lanceurs d’alerte » comme on dirait aujourd’hui, manquent d’un mot pour désigner l’innommable. C’est aussi que dans son livre publié en novembre 1944, Lemkin lui-même dilue la spécificité de la Shoah pour appliquer le terme de génocide à tous les groupes nationaux victimes du nazisme. Ainsi, il tend à « déjudaïser » le terme pour lui donner une portée plus universelle. À la même époque, les mémoires de Karski, Story of a Secret State, n’accordent aux Juifs polonais qu’une place réduite.
La libération du camp d’Auschwitz, le 27 janvier 1945, met le monde face à ces dénis. Le terme de génocide est intégré dès 1946 à un certain nombre de proclamations, comme la convention de l’ONU « pour la prévention et la punition du crime de génocide », en décembre. Mais le concept n’est pas retenu parmi les chefs d’accusation du procès de Nuremberg. La notion demeure fragile : sur un plan juridique, celle de « crime contre l’humanité » triomphe alors, sous les auspices de cet autre juriste de Lemberg qu’est Lauterpacht, en se référant à la protection des personnes, notamment civiles, alors que le terme de génocide se réfère à celle des minorités. Même admise par l’ONU, l’ampleur de la pensée de Lemkin semble diminuée car pour le juriste, le génocide recouvrait tant l’anéantissement physique et biologique que culturel. Ainsi, l’usage du concept demeure-t-il parcimonieux, alors même que son usage public connaît un succès inégalé et souvent inadapté : « le concept est devenu plus politique que juridique », note Annette Becker (p. 201). Pour des raisons différentes mais étonnamment convergentes, Lemkin et Karski participent d’une forme d’amnésie de la Shoah à partir des années 1950. Le premier, par souci d’assurer le succès d’un concept juridique encore fragile ; le second par préoccupation du devenir de la Pologne dans le contexte de la guerre froide, où l’histoire des Juifs polonais devient secondaire.
Annette Becker suit alors les aléas de la construction des deux « personnages-messagers » au cours des années 1980 : ce dernier et beau chapitre est en effet consacré à la construction de la figure du « Juste parmi les Justes » qu’est désormais Karski où « le témoin oculaire est devenu témoin moral » (p. 221). Un « second » Karski apparaît alors, à la faveur des œuvres d’Élie Wiesel, de Claude Lanzmann ou de Yannick Haenel. La mutation en même temps que la fictionnalisation de la figure de Karski est cependant cruelle : elle montre que le témoignage est nécessairement une trahison du message originel.
Le livre d’Annette Becker n’est pas seulement virtuose : il est important. À l’historien, il rappelle combien l’histoire d’un mot, d’une « idée devenu traité », est une aventure captivante pour autant qu’elle s’attache aux contextes de formulation et de réception. La force de l’histoire culturelle de la guerre montre ici ce qu’elle a de meilleur. Au lecteur non spécialisé, ce livre révèle l’actualité des questions posées par les messagers du désastre : on ne peut pas ne pas penser à l’aveuglement qui présida la gestion du génocide cambodgien ou tutsi, ou bien aux politiques de dénégation rampantes qui sont en vogue aujourd’hui de la Russie à la Turquie. Car cette incapacité à croire, à comprendre l’ampleur de la catastrophe qui semble aujourd’hui si scandaleuse lorsqu’on se réfère aux Alliés en 1942, n’est-elle pas aussi la nôtre ? Enfin, ce livre montre la richesse d’une notion qui est loin d’avoir acquis aujourd’hui l’ampleur que lui donna Lemkin en son temps. Si Annette Becker rappelle opportunément qu’il n’y a pas de fin à un génocide, en ce que le crime produit une souffrance transmissible et par conséquent inextinguible, son livre nous conduit à envisager le terme forgé pour le prévenir, le combattre et le punir dans son extension la plus large, non pas seulement comme un acte sous-jacent des crimes de guerre mais bien comme une catégorie particulière des crimes contre l’humanité.
À sa mort en 1959, Lemkin avouait que son combat était une réponse à l’anéantissement de sa famille gazée à Treblinka. Devenu citoyen d’honneur d’Israël en 1994, Karski, profondément croyant, patriote polonais puis américain d’adoption, disait aussi être devenu juif, « retrouvant la source spirituelle de [sa] foi chrétienne » (p. 229). Pour les « crieurs », tout ne serait finalement qu’affaire de mémoire, comme forme de fidélité aux disparus mais aussi à soi-même.
