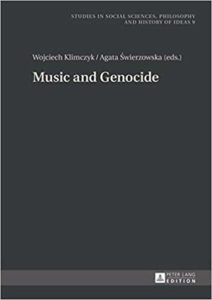Wojciech Klimczyk & Agata Świerzowska (dir.)
Francfort, Peter Lang, 2015, 244 p.
« En un sens », écrit Wojciech Klimczyk, l’un des responsables de cet ouvrage collectif, en des termes qui rappellent les dernières phrases de Nuit et brouillard, « nous sommes tous des survivants qui avons accidentellement échappé au génocide. Cela aurait pu nous arriver. Cela peut encore arriver. » (p. 13)
Dans le génocide, ce n’est plus la vie qui est la norme, mais la mort : c’est ce qui en fait, selon Leszek Sosnowski, contributeur du volume, le caractère unique. L’abandon de la vie dans chacun de ses aspects définit ce qu’il nomme une véritable Todeswelt : « le code de la mort sans l’alphabet de la vie » (p. 147), un horizon d’annihilation. Il cite Lyotard, pour qui l’Holocauste est un séisme qui n’a pas seulement détruit « des vies, des édifices, des objets, mais aussi les instruments qui servent à mesurer directement et indirectement les séismes » (Le Différend, p. 91).
Le génocide ne peut se résumer à la phase de l’extermination ; c’est un processus, pour lequel Gregory Stanton, dans un article de 1996, a identifié huit stades : classification, symbolisation, déshumanisation, organisation, polarisation, préparation, extermination et déni. L’un des chapitres du livre cherche à déterminer la part que la musique a pu prendre dans ces différentes étapes. Elle a eu, notamment, un rôle évident dans la première phase, à travers les tentatives de définition de certains peuples en termes pseudoscientifiques et raciaux. Les nazis tentèrent d’identifier dans telle ou telle musique des caractéristiques juives ; mais, le plus souvent, ils se bornèrent à déclarer « juive » la musique composée par un Juif. Au titre de la symbolisation – par laquelle on officialise les « découvertes » de la première étape –, est évoquée la parution, en 1940, du Lexikon der Juden in der Musik. Nous allons voir que la musique fut impliquée directement dans l’acte de tuer lui-même, et que la phase du déni ne l’a pas non plus épargnée.
La musique était utilisée pour organiser la vie quotidienne dans les camps, pour ritualiser certains actes. Il y avait de la musique quand les détenus arrivaient, quand des fugitifs étaient repris, lors des exécutions… Des chansons enfantines furent jouées pendant les déportations d’enfants juifs, à la fois pour couvrir leurs cris et pour tourner en dérision leur tragédie. Durant le génocide rwandais, l’extermination s’accompagna de chansons traditionnelles, familières, comme pour l’assimiler à une pratique routinière. Entre les mains des nazis, la musique fut surtout un instrument de torture. Comment ce sadisme musical trouvait-il à s’exercer ? En forçant les détenus à chanter, ce qui augmentait encore leur humiliation et leur souffrance ; en forçant les musiciens à jouer des airs légers presque sur les cendres des suppliciés ; en forçant les détenus à jouer ou à chanter pour des gardiens qu’ils savaient coupables du meurtre des leurs. L’utilisation de chansons de l’enfance par ceux qui voulaient les détruire provoquait chez les détenus une douleur infinie. Charlotte Delbo parle des « valses qu’on avait entendues ailleurs dans un lointain aboli. Les entendre là était intolérable » (Aucun de nous ne reviendra, p. 167).
La musique pourtant – plusieurs contributions insistent sur cette ambivalence – fut aussi une consolation, un réconfort, un moyen de survie parfois, de résistance, une façon de combattre la déshumanisation. Chanter restait l’une des rares formes d’expression possibles ; il y avait les chansons du temps de la liberté et celles composées dans le camp. Car de la musique fut composée, jouée et chantée clandestinement. On mettait quelquefois de nouvelles paroles sur d’anciennes musiques mélancoliques qu’on chantait dans un tempo plus lent qu’autrefois, les transformant alors en musiques de désespoir.
Wojciech Klimczyk parle en particulier du silence. S’il est difficile pour ceux qui n’ont pas vécu l’expérience des camps de faire entendre leur voix, il faut craindre aussi un certain silence, qui serait une figure totalitaire : « Le génocide rêve d’un silence dans lequel aucune voix particulière, unique, ne puisse plus être entendue » (p. 217). Certains Tutsi mouraient sans bruit ; c’est peut-être, nous dit Klimczyk, qu’ils se sentaient abandonnés par toute chose, même par leur propre voix. Peut-être ne croyaient-ils plus aux mots. Après le génocide, on n’a plus le droit de parler ni de rester silencieux. Mais une voix réduite au silence demeure une voix ; peut-être pourrait-on imaginer qu’une musique rende cette voix audible. Ce qui fait la différence entre la musique et le bruit, c’est le silence : le bruit déchire le silence quand la musique en est l’expression même. Les nazis sont parvenus à retrancher de la musique le silence : ils l’ont transformée en bruit. Un bruit qui était destiné à accompagner leurs meurtres.
Il n’y a pas beaucoup d’œuvres musicales directement liées à la mémoire de la Shoah. La plus célèbre, peut-être, est Un survivant de Varsovie de Schoenberg (1946), pour narrateur, chœur d’hommes et orchestre, qui évoque l’insurrection du ghetto de Varsovie. Un chapitre du livre est consacré à l’appréciation portée par Adorno sur cette cantate. Si Adorno, d’un certain point de vue, admire l’œuvre et la compare à Guernica, il la condamne pourtant sans merci. En transfigurant le destin des victimes, elle lui donnerait une signification et supprimerait quelque chose de son horreur. Comme le remarque Ralph Buchenhorst, une autre interprétation est possible : pourquoi le chœur final ne serait pas une expression de résistance ? Pourquoi faudrait-il le juger à l’aune du non-sens que constitue l’anéantissement des Juifs d’Europe ?
Un autre chapitre du livre, dû à Joanna Posłuszna, a pour objet trois œuvres du compositeur polonais Krzysztof Penderecki. La première œuvre étudiée, le drame musical Brigade de la mort (1963), suscita beaucoup d’indignation lors de sa création (un critique estima que c’était un crime de faire d’un tel sujet une œuvre d’art). À l’époque, on considérait généralement « que les blessures causées par l’Holocauste étaient si douloureuses que la seule chose à faire pour les artistes était de demeurer silencieux » (p. 192). Penderecki voit dans son Dies irae (1967), oratorio dédié à la mémoire des morts d’Auschwitz, une œuvre reflétant la victoire de la vie sur la mort. Composée beaucoup plus récemment (2009), Kadisz, pour soprano, ténor, narrateur, chœur d’hommes et orchestre, est une pièce profondément émouvante et recueillie.
Une contribution est consacrée à la partition de Hanns Eisler pour Nuit et brouillard d’Alain Resnais (1955). Matt Lawson y examine trois thèmes musicaux : celui du générique de début (qui revient à la fin du film), le thème pastoral d’Auschwitz et le thème des nazis. Pour ces deux derniers thèmes, Eisler, qui était opposé à tout usage descriptif ou référentiel de la musique, a opté pour l’ironie, l’« anti-littéralisme ». Au moment du thème « pastoral », où domine la flûte traversière, c’est sans doute le texte de Jean Cayrol (« Même un paysage tranquille… ») qui lui a suggéré ce décalage. Mais on retrouve la même distance dans le thème associé aux nazis (en pizzicati). Quant au motif « de Hitler », il est fait de la répétition énigmatique de deux notes dans l’extrême aigu du violon solo. Comme le remarque Lawson, les films de guerre « traditionnels » avaient une tout autre façon de représenter musicalement l’ennemi. Le choix d’Eisler donne naissance à une partition « riche de neutralité émotionnelle et de détachement à l’égard des images qu’elle accompagne » (p. 186).
Le compositeur et musicologue américain Lawrence Kramer signe l’épilogue du livre. S’étant demandé lui aussi quelle musique était possible pour faire mémoire du « siècle du génocide », il a écrit une œuvre, A Short History (of the 20th Century), pour voix soliste et percussion, au long de laquelle sont prononcés successivement les noms de quarante-huit lieux marqués par un crime de masse, depuis 1914 jusqu’au 11-Septembre. Dans cette œuvre, qui selon le compositeur n’est pas une lamentation mais un mémorial, les noms des lieux condensent les noms de ceux qui y ont péri. Au sein de la composition, chacun des noms doit être agencé et chanté d’une façon qui corresponde à sa résonance unique.
Sous l’influence d’une vision idéalisée de la musique, beaucoup ont dénié le rôle « criminel » qu’on lui a fait jouer dans les camps de la mort. Une vision dangereuse, relèvent les auteurs, en ce qu’elle tendrait à occulter le fait que les génocides sont perpétrés par des êtres humains, dont la musique est une des activités. Cette idéalisation va de pair avec une personnification : à force de parler de « la musique », on finit par croire que c’est une personne et qu’elle agit elle-même. C’est ce qui a fait écrire – bien inconsidérément – à Pascal Quignard, dans La Haine de la musique (1996) : « La musique est le seul, de tous les arts, qui ait collaboré à l’extermination des Juifs organisée par les Allemands de 1933 à 1945. » La musique est entre les mains des hommes : on ne peut pas plus lui attribuer leur génie que leur monstruosité.
Publié dans Mémoires en jeu, n°5, décembre 2017, p. 144-145