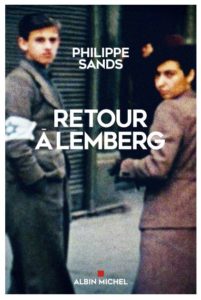Philippe Sands
Traduit de l’anglais par Astrid von Busekist
Paris, Albin Michel, 2017, 540 p.
Faisant de la coïncidence ou du hasard un moteur de ses histoires, le juriste et avocat Philippe Sands nous conte la naissance de deux concepts aujourd’hui au centre du droit international : le « crime contre l’humanité » et le « génocide ». Il prend prétexte d’une conférence à Lviv en Ukraine pour se lancer dans des enquêtes croisées sur la vie de quatre personnages liés à la ville. D’abord, les deux grands juristes pères de ces concepts, Hersch Lauterpacht et Raphael Lemkin, nés dans cette région et qui ont fait leurs études de droit dans la même université (où ils entrent respectivement en 1915 et 1921), mais pas dans le même pays : Lemberg, ville de l’Empire autrichien, devient Lwów dans la Pologne indépendante. Ensuite, apparaît Hans Frank, l’avocat de Hitler et le maître du Gouvernement général (la majeure partie de la Pologne occupée) de septembre 1939 à janvier 1945, et donc de Lwów après juillet 1941. Responsable de l’assassinat de millions de Juifs et de Polonais, dont les familles de nos deux juristes, Frank fut l’un des accusés principaux du procès de Nuremberg où se sont affrontées en coulisse les conceptions de Lauterpacht et de Lemkin. Enfin, le grand-père de l’auteur, Léon Buchholz, qui habita à Lemberg/Lwów dans la même rue que la famille Lauterpacht et qui, réfugié à Vienne en 1938, dut quitter précipitamment la ville, laissant derrière lui sa femme et sa fille d’un an.
Sands conduit ses investigations à la manière d’un juge d’instruction ou d’un Daniel Mendelsohn. Il tient le lecteur en haleine, même si la trame s’enlise parfois dans des détails inutiles, un narcissisme irritant et des platitudes historiques. On comprend assez vite que l’histoire de la Pologne n’est pas son affaire : il n’évite ni les clichés ni la caricature (sur le Traité des minorités, par exemple). Finalement, ces quatre récits convergent à Nuremberg en 1945, procès historique où triomphe un nouveau principe du droit : les États ne disposent plus d’une souveraineté absolue sur leurs ressortissants. Ce livre a donc le mérite d’introduire le lecteur dans le monde complexe et méconnu du droit international.
En revanche, le récit des crimes et de l’idéologie des tueurs à travers la carrière de Frank, ou des tourments de son fils Niklas alors petit enfant, n’apporte rien à notre compréhension du fonctionnement d’un nazi. L’auteur se noie dans des hypothèses psychologiques peu convaincantes, sans s’intéresser aux questions abondamment discutées par l’historiographie ces trente dernières années (ses conflits avec Himmler et Heydrich, le pragmatisme désordonné – et meurtrier – de l’organisation du Gouvernement général, la corruption, la politique des ghettos, l’Aktion Reinhardt, les méthodes d’extermination, etc.). Il se demande un peu naïvement comment un homme cultivé, grand juriste, « passionné de Jean-Sébastien Bach » (p. 358), a pu commettre de tels crimes.
Mais ces lourdeurs et approximations n’enlèvent rien à l’intérêt de ce livre de 540 pages. Les histoires principales, les plus proches de l’auteur en fait, sont traitées de manière convaincante. Celle de sa famille en premier lieu se construit autour d’un mystère obsédant. En 1938, son grand-père, Léon, jeune marié et père d’une petite fille d’un an, un commerçant de Lwów réfugié à Vienne, fuit à Paris. Il est rejoint par sa fille alors que la mère (sa femme) reste encore plusieurs années loin de son mari. Pourquoi cette séparation ? Que s’est-il passé à Vienne ? Le récit de l’enquête est captivant. On y découvre des personnages extraordinaires, comme une évangéliste aventurière, Miss Tilney de Norvich, ou des amants étranges en culottes tyroliennes. De belles pages évoquent le sort de ces réfugiés juifs, leurs angoisses et leurs douleurs. L’enquêteur interroge sans cesse le silence du grand-père qu’il a beaucoup fréquenté, et l’énigme des documents (photos, billets, objets…) trouvés dans ses affaires après sa mort. Le style du récit tire profit du savoir-faire juridique de l’auteur. Celui-ci rapporte sans émotion, avec un détachement et une clarté toute professionnelle, des événements bouleversants, des témoignages émouvants comme celui d’une jeune fille à Lwów qui voit de sa fenêtre sa mère arrêtée, puis son père qui tente de la rattraper et disparaît.
La deuxième histoire, où réside l’intérêt principal du livre à notre avis, est fondée sur les portraits d’Hersch Lauterpacht et de Raphael Lemkin. Elle nous oriente avec précision dans une discussion juridique complexe et capitale, pendant et après la guerre, pour une innovation radicale en droit international. Philippe Sands, avocat franco-britannique spécialisé dans la défense des droits de l’homme, professeur de droit à l’University College de Londres, auteur de plusieurs ouvrages spécialisés, sait trouver la forme d’exposition adéquate. En effet, les deux juristes qui nous occupent, chacun frappé dans sa famille par les crimes nazis, ont très tôt cherché à introduire dans le droit une qualification spéciale pour ces massacres. Lauterpacht, titulaire de la prestigieuse chaire de droit international à Cambridge associée au Trinity College, avocat et conseiller du roi, portant perruque, en a l’occasion pratique dès 1942. Il entre en contact avec le juge Robert Jackson, futur procureur en chef pour les Etats-Unis au procès de Nuremberg, qui l’intègre à la Commission des crimes de guerre fondée suite à une déclaration, en janvier 1942, de huit gouvernements alliés. En 1945, il figurera parmi les procureurs britanniques lors du procès. Jackson lui demande de réfléchir à la qualification des crimes, question qui divise les Alliés. Lauterpacht propose que « les violations des lois de la guerre soient jugées comme des “crimes de guerre” », puis « de se référer aux atrocités contre les civils sous le terme de “crimes contre l’humanité” » (p. 154). Ainsi s’est imposée dans le droit international une nouvelle désignation qui, selon son auteur, garantirait les droits des individus face à l’État, où qu’ils soient. Elle étendait le domaine de protection couvert par le droit international. « Les États ne pourraient plus traiter leurs populations comme ils le voulaient. » (p. 155)
Différente, sinon opposée, est la conception avancée à la même époque par Raphael Lemkin. Homme passionné, truculent, dandy et collectionneur d’art, six ans procureur dans la Pologne d’avant-guerre, Lemkin avait participé aux premiers efforts de la Société des Nations pour développer un droit pénal supranational (conférence de Madrid, 1933). Il avait suivi de près l’évolution du droit allemand après 1933, en particulier les lois de Nuremberg contre les Juifs. Dès l’attaque allemande contre la Pologne, conscient du danger, il avait quitté Varsovie le 6 septembre 1939. Il avait tenté de convaincre sa famille de le suivre, pour qu’elle se retrouve du côté soviétique. En vain. Un moment réfugié à Vilnius, il finit par rejoindre les États-Unis, en avril 1941, après un long et aventureux périple en train et en bateau (via Stockholm, Moscou, Vladivostok, le Japon, Vancouver, Chicago…). Sa famille restée près de Lwów sera assassinée par les Einsatzgruppen quelques mois plus tard.
Pour avoir vu les nazis à l’oeuvre et compris leur antisémitisme, il a tout de suite saisi qu’ils ne s’en prenaient pas seulement aux personnes, qu’ils voulaient détruire des groupes en tant que tels (Juifs, Polonais, Lituaniens, etc.).
Juriste expérimenté, Lemkin a immédiatement réuni le maximum de documentation sur les décrets nazis (dont ses valises étaient pleines, à la stupeur des douaniers ! ), et il a pris au sérieux leur signification pratique. Cherchant lui aussi à introduire un nouveau terme, il invente un mot qui amalgame le grec genos (« tribu » ou « race ») et le suffixe latin –cide : « génocide ». Le génocide écrit-il, concerne les actes « dirigés contre des individus, non pas en tant qu’individus, mais comme membres d’un groupe » (p. 232). Il publie en 1944 un livre détaillant son analyse, Axis Rule in Occupied Europe [édition française par Jean-Louis Panné, sous le titre Qu’est-ce qu’un génocide ? , éditions du Rocher, 2008], livre qui circule dans les milieux juridiques américains et britanniques. Ses sources impressionnent (il est le premier à analyser en détail le droit nazi), on l’écoute et il est, pour un moment, associé aux travaux du Bureau des crimes de guerre, puis écarté. La notion de génocide n’est pas retenue dans la charte de Nuremberg signée le 8 août 1945. « La liste des crimes figurant à l’article 6 comportait les crimes contre l’humanité – suivant la proposition de Lauterpacht – mais non le génocide » (p. 239), remarque Sands.
Dès lors commence un affrontement sourd, puis explicite, dans les coulisses du procès. Philippe Sands le décrit avec minutie, non sans manifester une préférence pour les conceptions de Lauterpacht. Si certains épisodes peuvent avoir eu une dimension personnelle – le professeur britannique tend à considérer son confrère polonais qu’il n’a jamais rencontré comme un amateur –, il y a bien un désaccord de fond. Sands le résume ainsi : Lauterpacht « s’opposait à une identité de groupe définie par le droit, qu’il s’agisse des victimes ou des coupables. […] En se focalisant sur l’individu, et non sur le groupe, il voulait juguler le potentiel conflictuel entre groupes. C’était une vision rationnelle, éclairée, mais aussi idéaliste. À ce raisonnement, Lemkin opposait le contre-argument le plus solide. Il n’était pas hostile aux droits des individus, mais il pensait qu’il était naïf de leur conférer une trop grande importance : la réalité des conflits et de la violence était telle que les individus étaient menacés en tant que membres d’un groupe particulier, et non en raison de leurs caractéristiques individuelles » (p. 345-346).
Lemkin ne s’avoua pas vaincu, exerçant une forte pression sur les juges. Si le crime de génocide n’est pas cité dans l’énoncé du jugement de Nuremberg, il a été évoqué dans plusieurs réquisitoires, et sera repris dans certains procès « internes » qui suivirent, notamment en Pologne. Pourquoi ce désaccord ? Philippe Sands nous en donne une explication politique. Lemkin « dut faire face aux objections politiques venant des États-Unis et du Royaume-Uni, en raison du traitement historique des Noirs aux États-Unis et des pratiques coloniales britanniques » (p. 395). Des raisons pratiques sont également invoquées : « Comment administrer la preuve d’une destruction intentionnelle d’un groupe ? » (p. 395) D’autres pensaient même que « s’intéresser au groupe était la meilleure manière d’encourager l’antisémitisme et l’antigermanisme » (p. 396).
Ce qui n’a pas découragé Lemkin. La dynamique du débat s’est maintenue après ce premier procès. Et, les années suivantes, l’ONU adopta les deux termes. La résolution 95, votée le 11 décembre 1946, reconnut que le crime contre l’humanité faisait dorénavant partie du droit international, tandis que la résolution suivante, n° 96, affirma que le « génocide est un crime au regard du droit international » (p. 441). Ce qui aboutit à l’adoption par l’Assemblée générale de l’ONU, le 9 décembre 1948, de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide préparée par Lemkin, et le lendemain, le 10 décembre, de la Déclaration universelle des droits de l’homme à laquelle travailla intensivement Lauterpacht.
Pour Philippe Sands, qui intervient en tant qu’avocat dans les procès internationaux mettant en cause des crimes de masse (ex-Yougoslavie, Rwanda, Chili, Soudan, etc.), « une hiérarchie informelle s’est imposée. Dans les années qui ont suivi le procès de Nuremberg, le terme de génocide a suscité un vif intérêt dans les cercles politiques et les débats publics. Il est devenu le “crime des crimes”, élevant la protection des groupes au-delà de celle des individus » (p. 445). Sands semble le regretter…
Publié dans Mémoires en jeu, n°6, mai 2018, p. 138-140