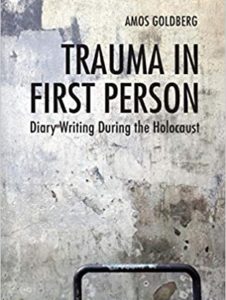 Amos Goldberg
Amos Goldberg
(traduit de l’hébreu par Shmuel Sermoneta-Gertel et Avner Greenberg)
Bloomington, Indiana University Press, 2017, 296 p.
Les journaux intimes tenus par les Juifs pendant la Shoah ne font plus guère figure de nouveauté historiographique. Un certain nombre d’entre eux comptent parmi les textes emblématiques de cette période, qu’ils aient été tenus dans les ghettos (Januscz Korczak, Mascha Rolni- kaite…), les camps nazis (Esther Hillesum, écrits enfouis de Sonderkommandos…), les pays occupés (Hélène Berr, Anne Frank…) ou l’Allemagne du IIIe Reich (Victor Klemperer…). Pour autant, il n’existe étonnamment presque aucune étude d’ensemble de ce corpus1. Amos Goldberg, responsable du département d’histoire juive à l’université hébraïque de Jérusalem, contribue pour partie à pallier cette béance historiographique. Dans sa récente monographie, il approche ces sources sous un angle novateur : non comme un matériau purement documentaire éclairant tel aspect historique, mais comme un phénomène en soi, central dans la période de la Shoah, et comme des « récits de vie » (life-stories) (chapitre 1) qui font figure de « champs de bataille » (p. 50) sur lesquels les auteurs tentent de reconstituer leur moi ébranlé. Alors que l’écriture autobiographique est habituellement considérée comme pourvoyeuse de sens aux événements traversés et productrice – voire garante – d’une cohérence identitaire, Goldberg démontre que dans le contexte de la Shoah, elle perd cette faculté et sa fonction thérapeutique. Le récit de vie se fait alors récit du trauma, dont Goldberg cherche à démontrer le pouvoir destructeur – aussi bien sur le texte que sur la vie de l’auteur.
Au cœur de la réflexion de Goldberg se situe précisément le concept de trauma, généralement ignoré par l’historiographie alors qu’il s’agit pour lui d’une véritable clé interprétative pour appréhender la vie des Juifs pendant la Shoah et leurs textes autobiographiques. D’ailleurs, plus qu’une contribution à l’historiographie de la Shoah, Goldberg envisage son approche des journaux intimes comme une critique de celle-ci, en ce qu’ils permettent de déconstruire certains de ses stéréotypes véhiculés jusqu’à nos jours (chapitre 2). Malgré le bouillonnement historiographique des études sur la Shoah, elles persisteraient en effet (sur- tout du côté américain et israélien) à présenter un tableau paradoxalement aussi positif que possible, c’est-à-dire porté sur la facette active, résistante, combattive de la vie juive à cette période, en marginalisant ce qui contrevient à cette représentation. Cela revient, selon Goldberg, à laisser hors champ la perspective des victimes et plus largement la question de l’humain. Il montre ainsi que l’image de la victime de la Shoah reste sacralisée, quasi intouchable, figée dans un canon héroïsant qu’il est malvenu d’écorner. Selon ce dernier, les Juifs auraient toujours su préserver, en dépit des circonstances, leur vitalité, leur souveraineté et leur intégrité en tant qu’êtres humains, notamment par leur habilité à tracer une frontière étanche entre le monde extérieur dégradé et leur monde intérieur resté intact. Cette représentation polissée de la victime confine à la censure quand elle va jusqu’à motiver certains choix éditoriaux dans l’exclusion de passages non conformes (p. 108-111). Face à ce que Golberg nomme l’impuissance de l’historiographie à traiter l’impuissance radicale des victimes plongées dans des situations traumatiques (p. viii, 6), il se propose de revisiter cette image de la victime à l’appui de journaux intimes tenus dans les ghettos, les camps et l’Allemagne nazie, en explorant le champ méconnu de la désintégration de l’individu qui serait l’essence même de la Shoah. Il cherche à démontrer que ces sources témoignent précisément d’un profond ébranlement de leurs auteurs qui menace leur identité, leur unité, leur langage, et jusqu’à leur existence – avant même leur anéantissement programmé par les nazis. Goldberg place ainsi son étude dans le prolongement du questionnement du concept même de l’homme formulé dès 1947 par Primo Levi, auteur dont il reprendra également la notion de « zone grise » en l’appliquant au domaine de la conscience humaine (chapitre 9) dont il entend « explorer les profondeurs » (p. xi).
Après avoir consacré la première partie de sa monographie à en poser les fondements théoriques, méthodologiques et historiographiques, Goldberg propose deux études de cas dans les deux parties suivantes : les journaux intimes tenus en allemand à Dresde par le philologue Victor Klemperer et ceux du pédagogue Chaim Kaplan, écrits en hébreu, du ghetto de Varsovie jusqu’à sa déportation à Treblinka en 1942. Le premier est abordé à travers la question de la temporalité autobiographique et documentaire, qui se trouve radicalement bouleversée, voire abolie, dans les conditions d’événements traumatiques ; c’est également l’évolution de la place du « je » dans l’écriture diariste qui retient l’attention de l’auteur en tant que symptôme de la désintégration intérieure (chapitres 4 à 6). Le second journal intime offre un éclairage intéressant sur le rapport équivoque à l’idéologie nazie qui vient pénétrer la sphère intime du journal à travers le langage ; cette infiltration, dans le narratif des Juifs, de la rhétorique de ceux qui nient leur droit à l’existence, illustre ce que Goldberg nomme « la zone grise épistémologique » : le trauma efface la frontière entre meurtriers et victimes qui en est pourtant à l’origine (chapitres 7 à 9). Dans la conclusion de son analyse, Goldberg dresse une typologie de ce qu’il reste du « je » ébranlé, revient sur la fonction du « récit de vie » à la lumière du concept du trauma et interroge l’influence du nazisme sur la nature humaine.
La représentativité des interprétations de Goldberg peut paraître relative, dès lors que celles-ci se fondent essentiellement sur deux journaux intimes (bien que d’autres soient régulièrement convoqués) tenus par des intellectuels à la conscience historique forte, alors que la pratique diariste pendant la Shoah s’étendait à de larges couches de la société juive. Néanmoins l’originalité de la méthode de Goldberg, qui tient notamment à sa pluridisciplinarité, est indéniable : il mobilise les outils de l’histoire, de la narratologie et de la psychanalyse, se référant tout particulièrement aux concepts lacaniens (trauma, métonymie, « seconde mort » ou « mort symbolique » [chapitre 3] qu’il définit, dans le cadre des journaux intimes de la Shoah, comme « l’effondrement de systèmes producteurs de sens » et comme « l’abysse dans lequel les textes […] cherchent à ne pas tomber », p. 249). Il convoque des auteurs aussi divers qu’Hannah Arendt, Theodor Adorno, Emmanuel Levinas, Georgio Agamben, Louis Althusser, Sigmund Freud ou encore Paul Ricœur. Bien que parfois noyé sous des considérations théoriques qui le rendent par moments indigeste, cet ouvrage propose une lecture stimulante des journaux intimes de la Shoah qui mériterait d’être approfondie, notamment à l’appui d’un corpus plus large ou dans la perspective d’une étude comparatiste avec l’écriture diariste d’autres situations historiques de violence extrême.
1 Parmi les rares recherches sur ce sujet, voir Garbarini, Alexandra, 2006, Numbered Days. Diaries and the Holocaust, New Haven, London, Yale University Press ; Camarade, Hélène, 2007, Écritures de la résistance : le journal intime sous le Troisième Reich (1933-1945), préfacé par Peter Steinbach, Toulouse, Presses universitaires du Mirail.
