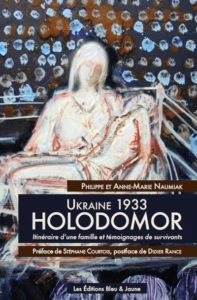Philippe & Anne-Marie Naumiak
Préface de Stéphane Courtois, postface de Didier Rance
Paris, éditions Bleu et Jaune, 2017, 288 p
En 2011, à la mort de son père, Philippe Naumiak trouve de la nourriture cachée dans son appartement, des boîtes de sardines dans le piano, du chocolat dans les armoires… « En Ukraine on m’a dit que c’était le symptôme des survivants du Holodomor. » (p. 103) Holodomor : le nom donné en Ukraine à la grande famine de 1933, et le titre du livre. Philippe et sa sœur Anne-Marie sont partis à la recherche, d’abord de l’histoire de leur famille, puis de celles de survivants qu’ils ont pu rencontrer en Ukraine : chemin faisant, ils témoignent aussi de leur mémoire indirecte, et de la transmission d’une mémoire « atrophiée » (p. 107), selon leur terme, celle du père. Ils se heurtent parfois au mutisme de ceux qui ont vécu la période, mais aussi à leurs propres réticences : « Des années durant, Sanglantes moissons de Robert Conquest et Le Prince jaune de Vassyl Barka sont restés sur mes étagères sans que je me décide à les ouvrir », avoue Philippe (p. 30-31). Et Anne-Marie fait part de ses cauchemars, « peuplés de scènes de cannibalisme, alors que […] je ne suis pas un témoin direct » (p. 64).
La famille Naumiak vivait à Sobolivka, un bourg autour d’une usine d’industrie sucrière, où travaillait le grand-père. Celui-ci fut arrêté et exécuté en 1937, durant la Grande Terreur, mais, comme il était ouvrier, sa famille ne fut pas spoliée ni « dékoulakisée ». Le père, Vitali, est né en 1926 en Ukraine soviétique, il avait sept ans au moment de la grande famine. Les enfants souffrent de rachitisme, la petite sœur de Vitali meurt du typhus, ou plus probablement de faim. Lors d’un retour à Sobolivka avec ses enfants, en 2006, Vitali se rappelle « la route de l’école empruntée en évitant de marcher trop près des maisons car des enfants disparaissaient » (p. 107) : sa mère leur racontait des histoires d’ogres pour les mettre en garde, les faits de cannibalisme étant avérés. En 1941, la Wehrmacht arrive. « Moi, dit Vitali, je n’ai pas vu de scène d’enthousiasme ni de chagrin. […] Je n’ai pas vu de Juifs arrêtés ni assassinés, ce n’est qu’en Allemagne que j’ai compris le triste sort qu’ils leur réservaient » (p. 38-39). À seize ans, il est déporté par les nazis comme Ostarbeiter : il connaît à nouveau la faim, les mauvais traitements, il participe au déblaiement des ruines de Cologne. À la fin de la guerre, comme il parle plusieurs langues, il est embauché comme auxiliaire par l’armée américaine, et se fait passer pour un Ukrainien natif de Pologne, pour ne pas être rendu aux Soviétiques.
Cette biographie, que le lecteur reconstitue après les auteurs, est en fait disséminée par bribes, au cours de souvenirs le plus souvent « anecdotiques ». Au fil du temps, la famille revient à plusieurs reprises en URSS puis, après la disparition de l’Union soviétique, commence à recueillir plus systématiquement des témoignages autres que familiaux.
Ce recueil de témoignages a une visée précise, il s’agit de documenter les meurtres de masse de l’année 1933, et les auteurs militent pour que le terme de « génocide » leur soit appliqué. « Si mes parents étaient restés à Chicago après ma naissance, ce livre n’aurait jamais vu le jour » (p. 56), écrit Philippe Naumiak, cela parce qu’aux États-Unis le génocide ukrainien est reconnu depuis 1983. En 2008, le Parlement européen reconnaît le Holodomor comme un crime contre le peuple ukrainien sans le qualifier de génocide. À partir de 1989, des collectes de témoignages ont eu lieu dans les campagnes, à l’initiative d’associations, de la presse locale, d’universitaires. Mais le temps a passé. Pendant la collectivisation, la famine n’a jamais existé officiellement, il était dangereux d’en parler. Puis la Grande Terreur (1937-38), la guerre, l’occupation nazie, la famine de 1947, ont « atténué l’aspect extraordinaire de l’année 1933 » (p. 110).
Pour qui s’intéresse à la problématique du recueil de témoignage, le protocole suivi ici mérite quelques précisions. Tout d’abord, les auteurs déclarent : « Nous avons supprimé pour beaucoup le récit de l’avant- et de l’après-génocide quand il n’apporte aucun détail significatif. Des témoignages ont été raccourcis de détails insignifiants ou techniques qui encombraient le discours. » (p. 116) Tout chercheur sait que l’insignifiant de l’un n’est pas forcément l’insignifiant de l’autre, et on regrette un peu ce choix sur les critères duquel on ne peut rien dire (dans quelques cas néanmoins, l’intégralité du témoignage peut être consultée sur le site de l’éditeur.) D’autre part, les témoignages, malgré quelques spécificités, sont homogènes et suivent un ordre à peu près identique : date de naissance, appartenance familiale (en général, paysannerie plus ou moins aisée, présence ou non de bétail), refus d’adhérer au kolkhoze, confiscations, expulsions, souvent déportation du père, puis description de la famine et de ses effets. Il est visible que ces réponses suivent l’ordre d’un questionnaire, qui n’est pas donné. Certes, un entretien non directif ou semi-directif est beaucoup plus coûteux en temps, et on peut estimer qu’un questionnaire est préférable dans ce type d’enquête ; mais il faudrait permettre au lecteur d’y accéder, ne serait-ce que pour voir les éventuels effets d’induction qui peuvent échapper à l’interviewer le plus honnête et le mieux intentionné.
Cela dit, les témoignages – près de quatre-vingt-dix – méritent tous l’attention. Émanant de personnes âgées, qui étaient enfants en 1933, ils sont généralement très concrets, proches de ce qui fut leur vécu : les corps bouffis, les soupes d’herbes, les maladies, les agonies, les morts, les perquisitions, les vols (« ils avaient fait de nos honnêtes paysans des voleurs » p. 130), les délations, le cannibalisme. Pour ce dernier point, certains cas sont documentés par des noms de personnes ou de lieux (« Dans notre village de Louhy, dix cas de cannibalisme furent enregistrés », p. 150). Presque tous en parlent : ainsi deux femmes, nées en 1924, du village de Dranka, racontent un cas de cannibalisme : l’une précise « Moi, je ne l’ai pas vu… » (p. 198), l’autre dit : « j’ai vu moi-même comment Nazar Chteïnyk et sa femme ont fait cuire leur enfant dans le poêle dans un chaudron… » (p. 200) et ajoute « Ma mère m’a interdit par la suite d’aller jouer vers chez eux » (p. 201). Un ou deux seulement précisent que c’est de seconde main : « Je n’ai pas vu de cannibalisme, mais je me souviens qu’à Motchoulka on disait qu’au marché de Sobolivka on avait vendu du pâté de chair humaine. » (p. 185)
Les adultes qu’ils sont devenus prennent parfois le temps de la réflexion, mais c’est assez rare. Les auteurs proposent une distinction intéressante entre deux types de témoins : « À l’inverse des témoins de la Shoah ou du Rwanda, les derniers témoins du Holodomor n’ont pas, ou peu, le recul et l’analyse des faits. Nous les appelons les témoins “extramnésiques” » (p. 109). À l’opposé, les témoins « intramnésiques » sont ceux qui opèrent une introspection de leur propre passé (p. 109). Parmi ces derniers, citons notamment celui-ci : « La famine a tout détruit : le mode de vie, les relations entre les gens, les coutumes, la culture. Après la révolution, les gens avaient obtenu des terres. Ils étaient devenus propriétaires. Avec quel amour ils labouraient, ensemençaient la terre et prenaient soin de leur bétail […] Et tout cela a été détruit, d’un seul coup. C’est comme si le village était mort de la peste ou comme s’il avait été brûlé » (p. 131-132). Autre témoin qu’on aimerait bien lire verbatim, mais qui n’est présenté qu’en résumé, celui qui dénonce les crimes de Staline, mais reste fidèle à l’Armée rouge, où il a combattu l’occupant nazi, et à la défunte Union soviétique : il ne peut « remettre en question la vie qu’il a passée dans un pays et un système dont il contribué, honnêtement, à l’édification » (p. 113).
Il s’agit d’un livre militant, dont le discours d’escorte (préface et postface) suffit à indiquer l’option d’ensemble. J’estime nécessaire de découpler l’information historique des conclusions que les auteurs en tirent. L’allusion incidente au « génocide vendéen » (p. 62) nous paraît significative : la haine de la Révolution n’a décidément pas de frontières.
Publié dans Mémoires en jeu, n°6, mai 2018, p. 142-143.