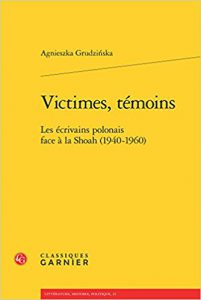Agnieszka Grudzińska
Paris, Classique Garnier, 2015, 474 p.
Victimes, témoins. Les écrivains polonais face à la Shoah (1940-1960), tel est le titre de la somme publiée par Agnieszka Grudzińska qui a réalisé là un travail pour l’histoire, à triple ambition face à la Pologne, au monde juif et à Israël mais aussi face à la France, puisque c’est en français que l’universitaire franco-polonaise a choisi de le publier. Professeur de littérature polonaise à la Sorbonne, elle s’est spécialisée dans les représentations de la Shoah en Pologne aujourd’hui. L’écho, le tremblement vécus par les poètes et les écrivains polonais avant, pendant et après le cataclysme, sous le pouvoir communiste, ne sont que fort imparfaitement parvenus jusqu’à nous, public francophone, même si la France et la Pologne ont toujours entretenu des liens intellectuels privilégiés. L’analyse des œuvres proposées ici, sous cet aspect particulier entre les Polonais témoins mais aussi victimes et les Juifs seulement victimes, appartient à l’histoire de la Pologne, à l’histoire des Juifs, à l’histoire du monde.
Ce livre fascinant nous propose non seulement une analyse littéraire mais philosophique, qui donne au volume une force supplétive avec une problématique au plein sens du mot. Il ne s’agit pas ici d’autofiction mais de la triple question du témoignage, du poétique et de « la fiction de l’Holocauste ? » (105), non à la manière des négationnistes ou des révisionnistes mais à celle des rescapés devenus écrivains ou poètes.
Après l’extermination de trois millions de Juifs polonais puis encore d’une centaine de Juifs après 1945, assassinés par des Polonais, on évalue à près de 160 000 Juifs le nombre de survivants encore en Pologne en 1946. Ils étaient 3,5 millions en 1939, mais en 1955, il n’en restait que « 69 000, 2 % de leur effectif d’avant la guerre » note A. Grudzińska. Comme l’Espagne du Moyen Âge, qui avait permis une symbiose entre catholiques, musulmans et juifs avant leur expulsion, au lendemain de la Reconquista, puis la terrible persécution de l’Inquisition pourchassant les nouveaux chrétiens accusés de « crypto-judaïsme », la Pologne, qui fut longtemps une terre d’accueil pour les Juifs venant d’Allemagne, d’Ukraine et un centre économique prospère, n’a pratiquement plus de Juifs aujourd’hui.
Les questions « que raconte-t-on ? », « qui parle ? », « Témoin = Martyr ? », conduisent immanquablement le lecteur, le chercheur, à s’impliquer dans les analyses d’Agnieszka Grudzińska toujours justes et convaincantes. La dichotomie réalité/fiction conduit l’auteure à remonter à Aristote et Platon pour analyser la place du poète dans la cité face aux grandes tragédies. Le maître de la poétique, de la métaphysique, a pu aussi créer le concept de la fiction littéraire, alors que Platon se méfiait des poètes, les rejetant hors de la cité. Entrons dans le vaste sujet de ce livre avec le plus célèbre poète-témoin polonais Czesław Miłosz (1911- 2004) qui, durant le soulèvement du ghetto de Varsovie, en avril 1943, écrit Campo dei Fiori suivi par Pauvre chrétien regarde le ghetto. Miłosz de par son prix Nobel de littérature est le plus célèbre écrivain polonais du siècle passé, donc le plus traduit. Son critique Jan Błoński dit à propos de Campo dei Fiori qu’il est « l’honneur de la poésie polonaise ». Son analyse déconcertante de « l’image de la taupe qui “avance/ Avec une petite lampe [rouge] attachée au front” fait voir la gardienne des corps : « Elle a les traits d’un Juif penché sur le Talmud ou sur la Bible » (162). Le critique fut vilipendé pour ses comparaisons jugées « anti-polonaises ».
Prenons comme référence Tadeusz Różewicz (1921-2014), né à Radomsk, écrivain, dramaturge, poète reconnu qui combattit dans la Résistance polonaise (AK) durant l’occupation nazie. Il écrivit un célèbre poème, La Tresse. A. Grudzińska compare Paul Celan à Różewicz car l’un comme l’autre abordent l’aporie du poème, de la langue confrontée à l’indicible, à l’innommable. Dans La Tresse, écrit en 1948, « Muzeum – Oświęcim – au Musée d’Auschwitz », le poète polonais parle des cheveux des femmes à la descente des trains, destinées à la chambre à gaz. Puis il se situe quelques années après au « Musée-mémorial » voyant « les cheveux raides de celles qui ont été étouffées dans les chambres à gaz », parmi lesquels voici « une petite tresse/une queue de souris avec un ruban/que les mauvais garnements/ tiraient à l’école. » Du coup, la petite fille à qui elle appartenait prend figure et sort de l’anonymat dans lequel les nazis ont voulu confondre les millions de victimes au premier rang desquelles les Juifs, les Slaves et les Tziganes. Est-ce cela « l’épiphanie négative » – le concept est de Ryszard Nycz (cf. 194 sq.) – qui se réfère avec Różewicz au schibboleth celanien ? Różewicz ou « le poète contre la langue ».
Dans son autre poème Der Tod ist ein Meister aus Deutschland, qui reprend la célèbre parole de Celan dans sa Todesfuge – Fugue de mort – et lui est dédié, Różewicz se place sous la double alliance Celan / Hölderlin, puisqu’il cite la question de l’auteur de Patmos, « À quoi sert le poète dans ce temps vain ? » (pour ma part, je préfère cette autre traduction : « Pourquoi des poètes en temps de détresse ? »).
Poème paradoxal sur le silence, l’exil – nous pourrions tout à fait reprendre le vocable superbe d’Alexis Nouss d’exiliance (La condition d’exilé, Paris, éditions Maison des sciences de l’homme, 2015) – sur l’inhabitation de la Parole pour le poète, c’est-à-dire pour celui qui est le porte-parole du silence et de la parole. Agnieszka Grudzińska lit la composition sous son double constat tragique : la fuite, la désertion des dieux, qui se clôt avec la mutité du poète à qui, pourtant, la Parole fut donnée de toute éternité, mais auquel elle est désormais retirée. Il y a dans la tradition juive l’extraordinaire notion cabalistique, mystique, du tsimtsoum, du retrait de Dieu, de l’exil du divin. Si au poète la Parole, son don propre, est retirée ou réduite à néant, n’est-ce pas alors que dans ce rien, il atteint l’épure du silence ? Różewicz l’avait compris, scrutant l’instant tu, la parole qui s’amuït. Dans Chaskiel, où il se fait si proche de Kafka avec son Gregor anxiogène au possible, de par sa métamorphose subite, il parle d’un personnage qui rêvait de disparaître. La disparition du témoin. La disparition de la victime. La disparition du martyr, par voie de conséquence. Ici, pour A. Grudzińska, le martyr est-il finalement la victime ou le témoin, puisque, en grec, martyr signifie témoin ? Le poète et le martyr ne font parfois qu’un, comme toutes les traditions nous l’ont rapporté.
La question est bien sûr au centre du foyer ardent de son sous-chapitre « Témoin = Martyr ? », qui ouvre à une interrogation encore plus abyssale (115), à savoir la question posée par Jean-François Lyotard, intenable pour beaucoup, qui ne tient pour légitime que le témoignage « de celui qui a perdu la vie », allant dans le sens de Primo Levi : les vrais témoins sont ceux qui ne sont pas revenus. On comprend ce qu’une telle thèse a d’insupportable quand on a entendu les rares témoins survivants, ceux qui sont revenus par hasard quand tous les leurs y sont restés et dont le devoir ultime fut de témoigner pour les morts. Que l’on nomme seulement ici Simone Lagrange Kadoche morte le 17 février 2016 à 86 ans (dont on a pu voir ou revoir le témoignage glaçant mardi 3 mai 2016 sur France 2, Moi, petite fille de 13 ans. Simone Lagrange témoigne d’Auschwitz : un documentaire d’Élisabeth Coronel, Florence Gaillard et Arnaud de Mezamat, produit par Abacaris Films) pour comprendre l’insoutenable d’une parole qui se voudrait d’autorité ou autorisée – fût-elle celle d’un Primo Levi ! On voit ce que cette thèse a d’insupportable même venant d’un survivant, alors on peut se demander de quel droit le cher et grand philosophe que fut Lyotard se permit-il de répondre à une question aussi abyssale ?
Puis Agnieszka Grudzińska consacre un important chapitre à Kazimierz Brandys (1916-2000), écrivain d’origine juive, qui eut le courage ou la folie de demeurer dans la Varsovie chrétienne durant l’agonie et la mort du ghetto, cachant ses origines, est-il utile de le souligner ? Un seul autre écrivain juif eut cette même folie, Adolf Rudnicki. Chez Brandys, on retrouve l’idée du «péché originel» des Juifs dans les temps de détresse, celui d’être né, décrit par André Frossard, Albert Cohen, mais avant eux par le célèbre docteur Janusz Korczak dans son Journal du ghetto, qui fonda à Varsovie la Maison de l’Orphelin qu’il dirigea encore à l’intérieur du ghetto, d’où il accompagna ses deux cents orphelins, avec tout le personnel de la maison, jusqu’à la chambre à gaz de Treblinka le 5 août 1942. Il évoquait ce souvenir d’enfance à propos de son canari, lorsqu’à sa mort il voulut l’enterrer avec une croix sur sa tombe, sa nounou le lui interdit parce que « le canari était juif » (Journal du ghetto, Robert Laffont, 1979 et 1998, trad. par Sofia Bobowicz, p. 44-45).
Parmi les grandes voix polonaises qui ont partie liée avec les victimes, voici Julian Tuwin (1894-1953), l’auteur de Nous, Juifs polonais, qui se considérait plutôt comme Polonais avant d’avoir été rattrapé par la folie nazie. Il ne se sentait nullement juif, précise Agnieszka Grudzińska si ce n’est par solidarité avec les plus proches parmi les assassinés, s’octroyant le titre de « Juif doloris causa » dans ce livre publié quarante ans après sa mort à Varsovie (Fundacja Shalom, 1993). Il écrit en majuscule dans le texte :
« ET VOILÀ QUE DANS CE NOUVEAU JOURDAIN, JE REÇOIS LE BAPTÊME : LA FRATERNITÉ SANGLANTE, BRÛLANTE, LE MARTYRE AVEC LES JUIFS. »
Il est impossible de terminer ce texte sans parler de Zofia Nałkowska (1884-1954) qui laisse une oeuvre magistrale rarement traduite et jamais en France. Notre guide en enfer, A. Grudzińska, scrute ici dans un chapitre particulièrement puissant ses Journaux écrits en pleine guerre, encore une fois dans Varsovie, où Nałkowska aussi fut témoin de l’annihilation de « la plus grande communauté juive du monde », pour reprendre les mots de Jean-Paul II dans son discours aux représentants de la communauté juive de Varsovie le 14 juin 1987. Dans son Journal des 28 et 29 avril 1943, Zofia Nałkowska écrit par exemple : « la réalité est supportable […] elle n’est pas visible toute entière non plus. Elle nous parvient – terrible et intouchable – dans les éclats des événements […] Je vis à côté de ça, je peux vivre ! […] ce n’est pas seulement un martyre, c’est aussi une honte » (328-329). Étrange texte où rien n’est nommé, où l’horreur est voilée… Son éditrice polonaise en 1996 a tenu à ajouter une note rappelant qu’il s’agissait «de l’insurrection du ghetto de Varsovie.» En revanche, dans ses Médaillons écrit en 1945-46, Zofia Nałkowska se fait entomologiste pour dire l’horreur de la destruction des Juifs de Pologne.
Agniesza Grudzińska nous apporte aujourd’hui un livre qui fera date sur les écrivains polonais face à la Shoah. Un livre que l’on ne referme pas comme si de rien n’était. Un livre qui vous habitera longtemps après l’avoir rangé dans sa bibliothèque et qu’il faut de façon urgente traduire en polonais si cela n’est déjà fait.
Paru dans Mémoires en jeu, n° 1, septembre 2016, p. 143-144