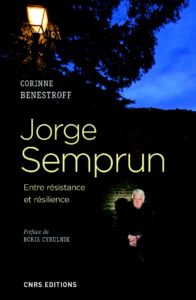 Le projet de thèse de Corinne Benestroff consiste à soumettre l’itinéraire complexe de Jorge Semprún à une analyse psychanalytique fondée en particulier sur l’étude de ses romans et ce qu’ils nous livrent de sa personnalité. « Entre résistance et résilience », précise le sous-titre de son livre paru en 2017 : une enquête qui « n’est ni une recherche historique, même si la contextualisation historique est présente, ni une biographie bien qu’y figurent les résultats d’une enquête sur Semprún et son entourage », une enquête qui « entrelace histoire, psychanalyse, critique littéraire, documents d’archives et paroles vives des témoins » (Benestroff, Jorge Semprún. Entre résistance et résilience, p. 21).
Le projet de thèse de Corinne Benestroff consiste à soumettre l’itinéraire complexe de Jorge Semprún à une analyse psychanalytique fondée en particulier sur l’étude de ses romans et ce qu’ils nous livrent de sa personnalité. « Entre résistance et résilience », précise le sous-titre de son livre paru en 2017 : une enquête qui « n’est ni une recherche historique, même si la contextualisation historique est présente, ni une biographie bien qu’y figurent les résultats d’une enquête sur Semprún et son entourage », une enquête qui « entrelace histoire, psychanalyse, critique littéraire, documents d’archives et paroles vives des témoins » (Benestroff, Jorge Semprún. Entre résistance et résilience, p. 21).
Le parcours personnel et politique de Jorge Semprún se trouve donc appréhendé à travers la résilience que Boris Cyrulnik présentait ainsi : « Quand une tragédie personnelle ou sociale fracasse le monde intime d’un individu, il se replie sur lui-même dans une position antalgique. Mais pour ne pas passer sa vie ainsi, il doit chercher autour de lui un attracteur social, une image identificatoire qui lui donne l’espoir de se remettre à vivre. Avide de héros, il cherche à rencontrer un modèle parmi ceux que lui propose sa culture [c’est moi qui souligne]. Le blessé réconforté se remet à vivre… » (Cyrulnik, p. 87) La vie de Jorge Semprún peut effectivement correspondre à ce schéma mais la vie de tout être humain n’y répond-elle pas ? La vie n’est pas un long fleuve tranquille… Dans le cas de Semprún, la première manifestation de résilience serait celle qui a suivi la mort de sa mère alors qu’il avait neuf ans. Viendraient ensuite l’exil en France, bientôt ravivé par la défaite de l’Espagne républicaine, puis l’arrestation comme résistant, la torture, et la déportation du tout jeune homme.
Jorge Semprún perd donc sa mère très jeune. On peut comprendre le traumatisme qu’il subit alors, mais il aurait été utile de s’interroger sur sa place dans la fratrie qui l’entoure : sept enfants, deux filles et cinq garçons. En réalité, on ne sait rien de la manière dont ce deuil a été vécu par l’ensemble de la famille, y compris le père, personnage trop négligé dont on ne rappelle que le remariage avec celle que Semprún a appelée jusqu’à la fin de ces jours « la marâtre ». Sa mère lui avait assigné un destin, celui de devenir écrivain. Le désir d’écrire – alors que Semprún est en train de sortir du tout politique au tournant des années soixante, de prendre le large en quittant un Parti communiste espagnol qui incarnait « la vérité globale, la raison historique » (Semprún, 1980, p. 425) – n’est-il pas nourri aussi du désir d’exaucer le voeu de sa mère, par-delà la mort ? Corinne Benestroff n’explore pas cette piste, de même qu’elle néglige le rôle du père, lecteur de Marx, lié au groupe Esprit et à sa revue, un père qui a joué sans doute un rôle plus important qu’on ne l’imagine dans les choix du jeune homme.
Cette question de la culture me semble, en général, trop négligée. On sait que, lycéen à Henri-IV, Semprún apprend la chute de Madrid en lisant Ce soir, journal communiste dirigé par Louis Aragon – indice d’une grande attention aux événements politiques européens qui le concernent directement, signe que, comme pour la jeunesse de cette époque, la marche du monde était au coeur de ses préoccupations. Qu’on me permette de citer à ce propos le témoignage de Michel Foucault : « ce qui me frappe aujourd’hui, lorsque j’essaie de faire revivre ces impressions, est que la plupart de mes grands émois sont liés à la situation. Je me souviens très bien avoir éprouvé l’une de mes premières grandes terreurs lorsque le chancelier Dollfuss fut assassiné par les nazis. C’était en 1934, je crois. Tout cela est très loin de nous maintenant. Rares sont les gens qui se souviennent du meurtre de Dollfuss. Mais j’ai le souvenir d’avoir été terrorisé par cela. Je pense que j’ai ressenti là ma première grande peur de la mort. Je me souviens aussi de l’arrivée des réfugiés espagnols à Poitiers ; et de m’être battu en classe, avec mes camarades, à propos de la guerre éthiopienne. Je pense que les garçons et les filles de ma génération ont eu leur enfance structurée par ces grands événements historiques. La menace de guerre était notre toile de fond, le cadre de notre existence. » (Foucault, p. 1 347)

© DR
Si l’on admet que Semprún, dès l’adolescence, se considérait comme républicain et était même disposé à suivre les analyses communistes concernant les questions internationales, on comprend qu’il ait accueilli le Pacte germano-soviétique du 23 août 1939 avec une certaine Schadenfreude – « La France et l’Angleterre étaient payées de la monnaie de leur pièce », c’est-à-dire punies pour n’être pas intervenues directement aux côtés de la République espagnole. On aurait garde d’oublier que le jeune homme maîtrise parfaitement l’allemand, ce qui lui ouvre en philosophie la possibilité de lire Marx, Hegel, Husserl, sans la médiation de la traduction mais aussi, dès qu’il fréquente la Sorbonne, la lecture de Lukács (Histoire et conscience de classe). C’est en français cette fois qu’il lit Emmanuel Levinas. Mais les études de philosophie peuvent-elles être considérées comme un « tuteur de résilience » (Benestroff, p. 30, 65, etc.) ? En tout cas, sa participation à la manifestation des étudiants le 11 novembre 1940 place de L’Étoile – manifestation, faut-il le rappeler, en partie organisée par les étudiants communistes – peut apparaître comme une étape le menant vers le ralliement à la résistance communiste au sein des Francs-Tireurs et Partisans, branche armée du PC. Néanmoins, on peut se demander quelle part la résilience occupe dans cet engagement. Je pencherais pour une plus grande prise en considération de la culture politique ainsi que du milieu auquel se trouve lié ipso facto Semprún – des personnes qui ont fait peut-être de lui, déjà, un communiste convaincu, nourri d’une conception stalinienne du monde, appréhendant la société par le biais des canons d’un marxisme-léninisme primaire. On peut prendre la mesure de l’importance de la culture en examinant l’origine« politique » d’hommes très différents devenus résistants tel Daniel Cordier, issu de l’Action française, tels les animateurs de Témoignage chrétien, tel le socialiste Daniel Mayer, ou encore ces anciens de la Cagoule qui fourniront ses cadres au service secret gaulliste…
Viennent ensuite les épreuves de la torture puis de la déportation. Le matricule 44 904 de Buchenwald sera conforté dans ses orientations politiques par sa prise en main par l’appareil communiste du camp qui lui assigne un poste et un rôle. Cette situation a pour conséquence d’ancrer chez Semprún l’idée de la fraternité des militants, même si celle-ci s’est exercée prioritairement au profit des camarades reconnus1. Les circonstances jouent, encore une fois, un grand rôle : « Je fais partie de la génération qui a eu vingt ans au moment de Stalingrad. » (Semprún, 1986) C’est bien au camp que s’est opérée sa « stalinisation », comme il l’a dit lui-même. De ces circonstances qui orientent la vie de Jorge Semprún pour près de vingt ans, peut-on en déduire une quelconque présence de la résilience ? Par contre, on pourrait considérer que le serment prêté par les déportés survivants lors de la libération (« l’auto-libération ») du camp a tenu une place importante dans la persistance d’un engagement dans l’action politique au détriment de la littérature et d’une première tentative littéraire dont Semprún a fait le récit lui-même dans L’Écriture ou la Vie. Qu’énonce ce serment : « Nous […] avons regardé avec une rage impuissante la mort de nos camarades […] Nous avons mené en beaucoup de langues, la même lutte impitoyable. […] Notre idéal est la construction d’un monde nouveau dans la paix et la liberté. Nous le devons à nos camarades tués [je souligne] et à leurs familles. Levez vos mains et jurez pour démontrer que vous êtes prêts à la lutte » (cité par Benestroff, p. 178-179).
Est-il inenvisageable de nos jours qu’un jeune homme d’à peine 22 ans soit impressionné durablement par un tel serment, d’autant plus qu’il a bénéficié d’une substitution d’identité opérée par l’appareil clandestin de la résistance intérieure au camp, réel « vol » d’identité d’un autre déporté mort, thème de son dernier roman, Le Mort qu’il faut ? C’est donc à cet épisode décisif que Semprún est enfin parvenu au bout de tant d’années. Il survit grâce à un homme presque son semblable – double improbable – qui, par là, rendait possible sa fausse identité.
Paradoxalement, la vie « contre l’écriture » signifie dans son cas l’enfermement dans un système idéologique qui conduit à nier le monde réel, dont il est question de hâter la fin pour faire naître un « monde nouveau ».
Tant dans ses romans que dans ses déclarations, Jorge Semprún a développé l’analyse de son propre itinéraire, parfois au moyen d’un Doppelgänger, ce que Corinne Benestroff met bien en évidence. Mais la fuite dans le militantisme marqué au sceau du fanatisme, sectaire et même sot, peut-il s’expliquer par la résilience ? Cela ne relève-t-il pas de la psychologie « classique » du militant prisonnier de son monde rêvé ? En revanche, le courage dont fait preuve Semprún en dévoilant son adhésion entière au communisme stalinien, allant jusqu’à publier ses poèmes à la gloire du « petit père des peuples » qu’il aurait pu si facilement dissimuler, semble bien correspondre à une catharsis qui permet l’échappée hors de l’univers politique communiste si rétréci. On pourrait dire que Semprún retrouve ses esprits et retrouve aussi la philosophie – dimension absente dans le livre de Benestroff – alors qu’à l’évidence elle accompagne le processus qui conduit à l’écriture à partir de soi2. Ce passage vers des retrouvailles est jalonné par des textes publiés qui l’opposent, par exemple, à Louis Althusser dans la revue communiste La Nouvelle Critique (1965) à propos du marxisme, ou celui paru dans L’Homme et la société intitulé « Économie politique et philosophie dans les Grundisse de Marx » (1968). C’est dire que l’aventure intellectuelle dans laquelle s’est lancé celui qui, encore en 1969, se déclare communiste est par trop absente de ce livre – alors que la lecture d’Une journée d’Ivan Denissovitch (1963) d’Alexandre Soljenitsyne avait fait entrevoir à Semprún la signification du Goulag, sans qu’il faille voir dans cette dimension du personnage une incompatibilité avec la démarche de Corinne Benestroff. C’est la raison qui, selon moi, fait qu’on ne peut écarter de la personnalité de Semprún ses faits et gestes, et surtout ses essais3 ainsi que ses préfaces4, jusqu’au livre de photographie Goulag de Tomasz Kizny (2003), qui sont autant de jalons intellectuels de son parcours. Autant d’éléments à intégrer dans une approche globale du personnage, non exclusivement psychanalytique. Il existe des analyses qui, sans recours au concept de résilience, nous disent beaucoup sur l’entrelacement de l’écriture et du vécu : dans cet ordre d’idée, Marie-Christine Pavis note que « le passé n’est pas donné une fois pour toutes, figé, mais qu’il se prête à des réinterprétations successives » (Pavis, §31), autre manière de dire que Semprún sait se servir de son intelligence pour livrer son témoignage à sa façon.
Les déportés n’en ont jamais fini avec le camp5. Une fois délivré de l’activisme politique, Semprún éprouve comme un retour de/en mémoire qui replace Buchenwald au centre de son existence et par là lui ouvre le champ de l’écriture. Mais, à partir des années 1980, au camp vécu viennent s’ajouter l’histoire et la non-mémoire de Buchenwald devenu après la guerre un camp soviétique pour les opposants de la zone est-allemande. Le camp (nazi) irrigue son écriture et sa réflexion envisage le phénomène du camp de concentration au XXe siècle dans sa globalité, intégrant l’histoire des camps soviétiques. Jorge Semprún, qui a retrouvé son identité, selon ses propres mots, à l’écoute du récit d’un camarade espagnol déporté à Mauthausen, se lance dans la rédaction du Grand Voyage (1963), son premier roman, qui lui permet indirectement de revendiquer son passé de déporté. « À partir de l’inattendu du premier saisissement créateur qui donne Le Grand Voyage et permet d’abandonner la lutte politique clandestine… », écrit Corinne Benestroff (p. 313), présentation contestable dans la mesure où, depuis plusieurs années – 1959 avec la grève générale pacifique prônée par le Parti communiste espagnol –, Semprún s’interroge sur la ligne politique du PCE, en vient à douter de sa validité, entrevoyant qu’elle opère dans « l’univers chimérique des rêves » (Semprún, 1978, p. 102). C’est ce doute, précédant la remise en cause directe, qui lui permet d’entendre le récit de son camarade. La faille s’élargira de plus en plus jusqu’à la rupture et l’exclusion. C’est peu après – effet de la découverte de Soljenitsyne – qu’il envisage de réécrire Le Grand Voyage, se remémorant les prisonniers russes et leur comportement si particulier formaté par la vie sous un autre régime totalitaire. Son projet aboutit à un nouveau livre, Quel beau dimanche ! , récit d’une journée à Buchenwald irriguée de réminiscences, de souvenirs, de réflexions. La construction interprétative de Corinne Benestroff peut donc être contestée.
Dès que sa mémoire devient active, Jorge Semprún possède la source des narrations qui vont se succéder. Cette mémoire en vie – point essentiel – est à l’origine de ses livres : « il m’arrive une chose particulière par rapport à la mémoire, par rapport à l’angoisse de l’oubli […] plus j’écris, plus la mémoire me revient », déclare-t-il dans un dialogue avec Élie Wiesel (Semprún & Wiesel, p. 18). Les étapes de ce « travail de mémoire » qui peut être provoqué par une sensation, une rencontre, génèrent ses livres successifs – une « écriture palimpseste », nous dit Benestroff (p. 335) – mais, pour autant, ces livres ont-ils eu pour fonction de transporter les propres troubles de l’auteur vers ses personnages de fiction, « à les transformer en objets externes moins envahissants » (p. 313) ? Rien n’est moins sûr car son dernier livre, posthume, tente d’aborder la question intime de la torture subie à la prison d’Auxerre, sans y parvenir véritablement en l’état du manuscrit tel qu’il est. Là encore on pourrait dire que Semprún cherchait à s’appuyer sur des « tuteurs de résilience », parlant de Stéphane Hessel, de Jean Améry. Cependant, ce n’est pas vers une description de la souffrance éprouvée dans sa chair (« la solitude abominable de la souffrance », Semprún, 2012, p. 48) que Semprún s’oriente mais vers le sens véritablement humain qui s’en dégage : « Et sans doute l’être du résistant torturé devient-il un être-pour-la-mort, mais c’est aussi un être ouvert au monde, projeté vers les autres : un être-avec, dont la mort individuelle, éventuelle, probable, nourrit la vie. » Cet « être-avec », c’est pour Semprún l’autre nom de la fraternité (ibid.).
Une fois achevé la lecture de cet énorme travail ayant pris pour objet celui qui se définissait lui-même comme un revenant qui « traîne derrière lui la cohorte de ses frères d’ombres » (p. 198) désormais ensevelis dans une tombe au creux des nuages, le lecteur reste avec ses interrogations : faut-il vraiment chercher à situer Jorge Semprún « entre résilience et résistance » ? N’est-il pas simplement ailleurs, au-delà de la résilience, concept si caoutchouc qu’on peut en user pour décrire n’importe quel parcours humain ? Au-delà de la Résistance, certes non, mais une résistance entendue comme acte situé historiquement. N’est-il pas la figure d’un homme tout empreint d’une permanente éthique de responsabilité vis-à-vis de ses compagnons de camp et de ses années où il s’était fourvoyé dans le communisme stalinien, un homme qui a trouvé, par le travail sur et à partir de sa propre mémoire en zigzags et la littérature, le moyen d’exprimer son expérience en ce XXe siècle effroyable et une dernière arme pour assurer une transmission : « Je ne crois pas à une littérature sur les camps écrite par des gens qui n’y ont pas été. Le témoignage n’est pas la vérité historique mais il est irremplaçable. Quand un survivant du Sonderkommando parle, rien ne le remplacera jamais. Plus fort que n’importe quel texte écrit, il ne donne pas seulement à imaginer, il donne à voir », déclara-t-il en 1995.
BIBLIOGRAPHIE
Benestroff, Corinne, 2017, Jorge Semprún. Entre résistance et résilience, Paris, CNRS éditions.
Cyrulnik, Boris, 2016, Ivres paradis, Bonheur héroïques, Paris, Odile Jacob.
Foucault, Michel, 1983, Ethos, interview par S. Riggins, repris dans Dits et écrits, vol. II, Gallimard, coll. « Quarto », 2001, p. 525-538.
Pavis, Marie-Christine, 2016, « Revenances et hantises dans les récits de camps de Jorge Semprún », Conserveries mémorielles, # 18, en ligne : https://cm.revues.org/2275
Semprún, Jorge & Wiesel, Élie, 1995, Se taire est impossible, Paris, Arte/Les Mille et une nuits.
Semprún, Jorge, 1978, Autobiographie de Federico Sanchez, Paris, Seuil, coll. « Points », 1996.
Semprún, Jorge, 1980, Quel beau dimanche ! , Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2012.
Semprún, Jorge, Interview dans Lire, no 126, 1986, p. 104-114.
Semprún, Jorge, 1995, interview, « Comment un camp nazi est devenu un camp stalinien », Libération, 10 avril 1995.
Semprún, Jorge, 2001, Le Mort qu’il faut, Paris, Gallimard.
Semprún, Jorge, 2012, Exercices de survie, Paris, Gallimard.
1 On sait que les militants trotskistes déportés n’ont pas bénéficié de cette fraternité.
2 Il aurait été peut-être utile de comparer les récits de Jorge Semprún à ceux d’un autre écrivain, je pense en premier lieu à Arthur Koestler (La Corde raide, 1952 ; Hiéroglyphes, 1954), dont la fréquentation des œuvres de Freud et d’Adler est connue.
3 Je pense en particulier à L’Arbre de Goethe. Stalinisme et fascisme (1986), à Mal et modernité (conférence Marc Bloch de 1990), à Une tombe au creux des nuages (1994), à Ni héros ni victimes. Weimar-Buchenwald (1995), à Une morale de résistance : Husserl, Bloch, Orwell (Grandes conférences de la BNF, 2002).
4 Préfaces à Nous autres de Zamiatine (1971), aux Nôtres d’Elsa Poretski (1985), à Un monde à part de Gustav Herling (1985), à L’Esprit révolutionnaire de Leszek Kolakowski (1985), à À une heure incertaine de Primo Levi (2002).
5 Pas plus que les prisonniers de guerre, dans un autre type de camps bien sûr, mais dont le silence est voisin de celui de certains déportés. Voir le livre de Georges Hyvernaud : La Peau et les os (1949), que l’on s’attendait à voir présent dans l’ouvrage de Corinne Benestroff, notamment pour la description du silence qui est imposé à Hyvernaud à son retour.
Publié dans Mémoires en jeu, n°5, décembre 2017, p. 118-121
