À propos du récit de H. Leivick, traduit du yiddish par Rachel Ertel1
Abstract : Leivick was a young Jewish revolutionary activist arrested in 1906 by the Tsarist police and sentenced to penal colony. After being relegated for six years, he escaped and settled in United States where he became one of the most famous Yiddish poets and playwrights. He managed to publish In the Tsarist Penal Colony only in 1958, the very poignant account of his terrible experience which can be reassessed now in the dark light of the more recent and violent history of the totalitarism. Remarkably translated by Rachel Ertel, this essential opus suggests to refound the notions of the modern humanism.
En 19061, tandis que le ministre Piotr Arkadievitch Stolypine réprime durement les troubles révolutionnaires qui agitent la Russie depuis 1905, un tribunal condamne un jeune militant du Bund, parti socialiste juif, à six ans de bagne et à la déportation en Sibérie. Il n’a que dix-huit ans se rêve poète, a rompu avec la pratique religieuse et s’est brouillé avec sa famille.
HORS DU TEMPS, HORS DU MONDE, HORS DE SOI
En traduisant Dans les bagnes du tsar, Rachel Ertel révèle un texte capital, d’une rare profondeur et d’une poignante beauté. Au moment de publier ce livre étonnant, en 1958, le poète H. Leivick, devenu figure éminente de la littérature yiddish, s’étonne lui-même : « Je plonge donc dans la densité de mes années de forçat à partir de 1908, tout juste un demi-siècle plus tard » (p. 17). Or, c’est bien là que surgit la question essentielle : pourquoi avoir attendu si longtemps pour relater dans un vaste récit en prose une expérience seulement évoquée jusque-là dans des œuvres dramatiques ou des poèmes2 ? De fait, le problème ne se limite pas à l’éloignement des faits, ni aux incertitudes de la mémoire, ni même à l’anachronisme du sujet : à quoi bon, pourrait-on se dire, dénoncer les crimes d’un régime disparu, dans un temps où des crimes bien plus épouvantables ont souillé l’Histoire, et surtout dans une langue elle-même quasiment disparue ?
Mais c’est précisément tout ce qui paraît ôter du sens à l’entreprise de Leivick qui lui en donne davantage. L’écrivain, parvenu à la consécration et au crépuscule de sa vie, ne cherche pas à atteindre une simple vérité autobiographique ni celle d’un témoignage dépouillé et rigoureux. Il espère moins dire qu’« expliquer » (ibid.), à la lumière inattendue qu’apporte le décalage historique :
Précisément parce que la situation actuelle du monde est brûlante et tragique et que ses conséquences sont encore imprévisibles, je reviens sur mes souvenirs d’il y a cinquante ans. Je veux me remémorer pour jeter une lueur, fût-elle obscure, sur le destin et les épreuves devant lesquels se trouve l’homme d’aujourd’hui. » (p. 19-20)
Mesurons bien la valeur de ce « parce que ». Primo Levi a bien montré que l’enfer concentrationnaire est par essence sans « pourquoi ». Certes, Leivick nous parle d’un détenu qui connaît la raison de sa condamnation et même la revendique. Mais il peint bien les geôles tsaristes comme un monde dans lequel, au début, n’est ni verbe ni lumière, entièrement réduit au silence et à l’obscurité d’un cachot. « Ni jour, ni nuit, ni temps ni son » (p. 22). Chaque nuit est semblable « à toutes les nuits carcérales » (p. 20). Tout repère disparaît, au point d’abolir la conscience. L’emmuré se demande : « Qu’est-ce que le non-temps ? Dans l’absence de temps on peut devenir fou […] » (p. 25). Monde, par conséquent, sans origine ni but, sans nécessité, sans causalité intelligible.
Très paradoxalement, donc, c’est dans cet espace-temps sans repère que l’écrivain fonde la revendication de sa liberté : « je n’ai changé que le nom des gens et parfois l’ordre des événements pour être libre dans mes choix et dans l’éclairage intérieur que je donne aux personnages et aux dialogues » (p. 18). L’écriture prend le pouvoir sur les faits en tant que tels. Le présent vient constamment se substituer aux temps du passé. C’est même le présent d’énonciation qui s’impose dans de vastes passages délibératifs, relevant du monologue intérieur3 ; ou dans d’amples dialogues traités comme de véritables scènes dramatiques, insérées dans un récit où disparaît souvent toute présence d’un narrateur4. Le fil chronologique est sans cesse coupé d’analepses. Les moments forts de l’enfance ou du procès de Leivick resurgissent alors, comme pour mieux remplir le temps vide de l’incarcération. C’est ainsi que l’écrivain met en scène l’extraordinaire tentative d’un dialogue avec son père, jamais commencé en réalité mais constamment poursuivi et repris dans l’imaginaire, tout au long du texte.
LA POÉSIE COMME RECONQUÊTE DE L’ÉTRE PERDU
Ne pouvant « retrouver le lien brisé avec [sa] pensée et [sa] vie de jadis » (p. 26) dans les ténèbres du cachot, le bagnard s’en remet au poète qu’il espère devenir : « Les murs ont disparu. À la place, un lointain vers lequel je vole sans prendre appui sur le plancher » (p. 31). D’abord appréhendée comme un tombeau, la prison se fait matrice dans laquelle temps et espace ne font plus qu’un. Les ténèbres enfantent un être nouveau, capable d’en prendre la mesure et de les parcourir en tout sens. Au lieu de dire simplement les choses comme elles sont, dans l’ordre chronologique où elles se suivent, s’émiettent, s’éloignent et se confondent, le poète se découvre le pouvoir d’exprimer ce qu’il vit en images, en visions pleines de signification, précises, cohérentes, aussi disponibles qu’un texte qu’on pourrait sans cesse relire et analyser. N’est-ce pas ce qui lui a manqué lorsque, enfant, il n’a pu communiquer avec le fou aperçu derrière une fenêtre barreaudée ? « […] Je lui tire la langue et la pose sur le barreau glacé. La pointe de la langue […] se fixe au fer. Quand je la retire, il en reste un bout de peau » (p. 269). Réduite à une chair impuissante et mutilée, la langue ne peut rien, sinon railler stupidement un être lui-même muet, dont la condition préfigure les épreuves que Leivick devra subir.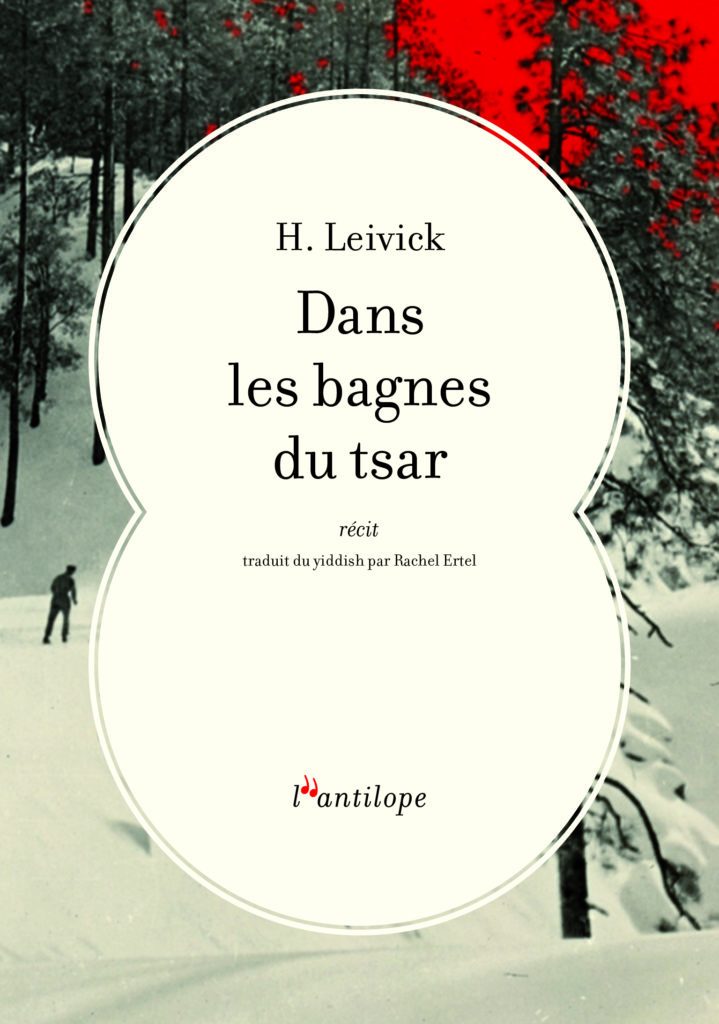
En cela, la composition symbolique du récit paraît révélatrice : la première partie, « Dans les bagnes du tsar », prête son titre à l’ensemble. Elle semble réécrire un des premiers poèmes de Leivick, « Sous les verrous », en l’explicitant et en l’inscrivant dans un contexte historique. La deuxième partie, « Sur les routes de Sibérie », reprend textuellement le titre d’un autre de ses poèmes. Comme si l’écrivain voulait faire apparaître entre son incarcération puis sa relégation, ces deux moments de sa terrible expérience, un lien dialectique. Tout commence dans la geôle étroite et obscure où Leivick est jeté pour avoir essayé d’ôter ses fers : « En étendant mes bras, je touche de mes doigts le mur d’en face » (p. 23). Mais tout finit dans un espace totalement ouvert, dont seul le temps peut donner la mesure : « là, commence la longue marche par les steppes de Bourat [Bouriatie] jusqu’au fleuve. Il faut compter entre douze et quinze jours » (p. 306).
Pour passer de la clôture à l’ouverture, du « non-temps » et du non-lieu aux chronotopes de la route et du fleuve qui mènent à l’exil sibérien, il faut avoir subi ce dérèglement du rapport au monde et à soi-même par la prison et la maladie : l’épidémie de typhus (p. 205-304) apparaît, à ce titre, comme une sorte d’épreuve suprême et élective. L’hôpital de la prison devient alors lieu d’une véritable renaissance. Dans la fièvre et le délire, sous le regard bienveillant du médecin (p. 257) et d’Orkè, l’ami qui a mal tourné mais qui s’est racheté au bagne par ses remords et son altruisme, s’opère une reconquête de soi. Par un retour à la mémoire personnelle, tout d’abord, avec le souvenir d’une enfance humiliée, de brutalités subies et de blessures intimes : « Je garde mon esprit et ma mémoire en éveil. Je tiens le compte de ma vie et de mes actes » (p. 271). Par une réappropriation de son héritage culturel, d’autre part, en relisant le Livre sacré à la lumière des leçons de sa propre vie : un jour, sur le chemin qui le menait au heder, un antisémite l’a frappé sous prétexte qu’il n’aurait pas ôté sa casquette en passant devant une église. Leivick se souvient alors du lien qui lui avait semblé s’établir entre le sacrifice d’Isaac et sa propre mésaventure : comme Isaac, il a subi non seulement sans comprendre, mais surtout sans pouvoir réagir.
Une question le taraude, depuis ce temps : certes, Isaac est sauvé, la main d’Abraham est arrêtée par l’ange ; mais « qu’est-ce qui se serait passé si l’ange avait été en retard d’une seconde ? » (p. 267). L’homme peut-il n’opposer à ce qui le menace que la foi du cohanim ? Ne doit-il pas plutôt se faire sujet agissant de son histoire et trouver des réponses humaines à ses questions d’homme ? Leivick semble entrevoir dans les interrogations confuses qui agitaient sa pensée cinquante ans plus tôt certains éléments qui nourriront bien plus tard celle de Hans Jonas, dans son essai, Le Concept de Dieu après Auschwitz5. À travers le Christ descendu de sa croix et revendiquant sa pure humanité, souffrante et humiliée, Leivick n’imagine-t-il pas déjà ce que peut avoir d’inquiétant l’idée d’un Dieu dépouillé de sa toute-puissance et d’une créature abandonnée à elle-même ?
AU PLUS SOMBRE DES CHOSES, LE POÈTE
De fait, c’est l’être moral tout entier qui se transforme. Très vite, le bagne ébranle toutes les certitudes du jeune homme. L’assassin qui vient partager son cachot lui inspire d’abord aversion et mépris. Pourtant, même la violence et la « trivialité » (p. 32) des propos de ce criminel lui rappellent une leçon essentielle, aussi utile au poète qu’à celui qui le lira : « Il ne reste au détenu aucune autre arme contre le monde et l’ordre établi, que sa langue » (ibid.). Et quand, dans les ténèbres glacées du cachot, le meurtrier lui offre sa capote, Leivick se rend compte que l’activisme révolutionnaire et l’institution répressive se rejoignent, finalement, en réduisant le monde à un manichéisme grossier, constamment remis en cause par la réalité humaine. Certains détenus « politiques » ne valent pas mieux que bien des « droit commun ». Même parmi ses gardiens, le forçat trouve parfois respect, honnêteté ou bienveillance. Ainsi ce soldat que Leivick finit par désigner comme son « compère » (p. 354) ou son « double » (p. 403).
Plus surprenant encore : c’est dans le microcosme du bagne que le jeune révolutionnaire et ses camarades d’infortune réévaluent la possibilité d’une société idéale, l’utopie qu’ils rêvaient de réaliser par la violence : l’obligation de survivre ensemble, de s’entraider, d’exister dans la cellule commune ou sur le bateau-prison, en permanence sous le regard des uns et des autres, amène sans arrêt à repenser le pacte social et l’action politique. Le huis-clos de la cellule où sont regroupés quatre « politiques » et quatre « droit commun » devient le théâtre d’une révélation capitale, puisqu’elle oblige à prendre conscience que le terroriste révolutionnaire n’est souvent pas plus pur que le criminel : Elik a tué son patron, dénoncé comme briseur de grève et mouchard. Or, il sait depuis que cet homme était innocent. Dévoré de remords, il voudrait être rejugé pour ce crime, ignoré de la police tsariste (p. 210-213). Bassanov, quant à lui, un « pogromiste », a massacré à coups de hache une famille juive. Mais il prétend n’éprouver aucun remords, prie sans cesse ou relit les Évangiles et se persuade que Jésus lui pardonne (p. 240). Leivick, malade, a « la tête en feu » (p. 242) quand ce sinistre personnage lui montre de l’humanité en lui proposant un peu d’eau et en lui racontant avec une terrible naïveté les actes affreux qu’il a commis.
Le bagne, en quelque sorte, semble conduire à ne plus s’ériger en juge, à assumer ses faiblesses et celles de l’autre comme universelles marques de l’humaine condition. Leivick, dans le délire du typhus, croit revoir Raya, une condamnée avec laquelle il avait noué une brève amitié. Il lui avoue une lâcheté qu’il se reproche encore des années après : au cours d’une émeute, face aux fusils des soldats, il aurait reculé du premier au troisième rang. « Si tous les juges étaient si sévères avec eux-mêmes, le Messie serait venu depuis longtemps », répond-elle (p. 275). De fait le long périple qui mène le poète, à travers les steppes, jusqu’au lointain village de Vitis est l’occasion de comprendre et d’accepter cette fragilité commune. Il est aidé en cela par Chapiro, philosophe désabusé, plein d’indulgence pour Lazebnick, un camarade pourtant indigne, geignard, égoïste et simulateur. Mais c’est de Slava, la belle condamnée dont il tombe amoureux, que Leivick reçoit la leçon la plus utile pour lier cette morale sans raideur à son désir d’être poète. En cellule, il se demandait, face au corps martyrisé et aux souffrances d’un codétenu flagellé, « comment le transformer en poème qu’[il] voudrait écrire » (p. 190). Mais en cheminant à côté de Slava, dire la réalité la plus prosaïque de ce qu’il vit avec elle lui fait définir la vraie nature de la poésie : « La capote nous fait transpirer, les godillots tapent sur la route. – Vous n’êtes donc plus poète ? – Si, je suis toujours poète puisque vos godillots chantent en moi. – Des godillots peuvent chanter ? – Tout peut chanter » (p. 371).
DES TÉNÈBRES AU SENS
Certes, « tout peut chanter », même l’horreur des bagnes tsaristes. Surtout quand on les revisite dans la profondeur d’un demi-siècle d’histoire. Un thème parcourt le livre de Leivick : la cécité, d’abord évoquée comme égarement d’un homme tâtonnant dans le noir d’un cachot : « tant qu’on n’a pas connu l’obscurité en plein jour, on ne sait pas, on n’a pas la moindre idée de ce que signifie toucher les ténèbres » (p. 22). Mais cet aveuglement initial, imposé par la prison, paraît très différent de la cécité partielle qui affecte Leivick pendant la traversée de la Sibérie. Le « vieil homme merveilleux » qui lui a offert son secours dans l’orage où il a failli périr lui en apprend toute la valeur : « ce que tu as vu en aveugle est plus que ce que tu aurais vu avec tes yeux de voyant » (p. 455). Significativement, ce personnage mystérieux s’appelle Élie, comme le prophète constamment évoqué par Leivick, souvent associé au Messie ou au Christ. Tout ceci concourt à faire apparaître la dimension littéralement apocalyptique du texte.
Le poète comprend d’abord que le système oppressif tsariste contenait les germes de toutes les oppressions futures. Certaines, même, comme le lui suggérait la clairvoyante Raya (p. 117), nées de la dénaturation des premiers idéaux de Leivick : « Le pouvoir soviétique a repris le même régime carcéral et l’a rendu encore plus terrible » (p. 100). Mais comme il semble vouloir le rappeler dans les vers cités par Rachel Ertel, « À Treblinka [il] n’a pas été / Pas plus qu’à Maïdanek » (p. 11). A posteriori, l’écrivain observe que le goulag ou le cauchemar concentrationnaire et génocidaire des nazis sont plus que de simples imitations ou continuations du bagne tsariste. Ils en changent profondément la nature :
Chez le détenu politique, le bagne tsariste portait atteinte à sa liberté plus qu’à sa personnalité. Il réprimait le politique, de façon parfois absurde, mais il n’entamait pas sa personnalité, la laissait tranquille, sois ce que tu veux. Préserve-la ou détruis-la. Le bagne laissait au forçat son libre-arbitre, si l’on peut dire. » (p. 124)
Les bourreaux du bagne eux-mêmes apparaissaient alors plus aliénés que leurs victimes, exécutant brutalités et châtiments « de façon mécanique » (ibid.). Leivick pense même « qu’ils en avaient honte » et affirme que « l’admiration pour les bourreaux et les tortionnaires, et pour le plaisir qu’ils pouvaient en tirer, n’apparut que bien des années plus tard, sous Staline et Hitler » (p. 125).
Réécrite à la lumière de l’expérience historique, l’épreuve vécue individuellement prend valeur d’une terrible apophétie, seulement intelligible après l’événement impensable. Ainsi trouve son sens l’intuition par laquelle Leivick justifie son projet d’évasion vers l’Amérique, qu’il confie à Slava : « Je suis attaché à la littérature yiddish et au destin juif. Je veux être un poète yiddish. En ce qui concerne le sort des Juifs, j’ai un mauvais pressentiment sur son avenir en Russie » (p. 471). Par là, tout l’implicite du livre paraît inviter à mieux prendre la mesure du caractère abominable et spécifique des « événements monstrueux dans le monde juif et dans l’ensemble du monde » (p. 19) qui obsèdent le poète quand il décide d’écrire Dans les bagnes du tsar. Tout au long du texte, on entend parler un homme tourmenté par la crainte de perdre sa foi en l’homme. Mais en 1958, cet homme est peut-être davantage le lecteur auquel Leivick s’adresse. Pourrait-on comprendre autrement l’importance qu’il prête à la figure et aux paroles d’Élie Dobin, le « vieillard merveilleux »? « Un homme n’est jamais éloigné d’un homme » (p. 452). ❚
1 H. Leivick, Dans les bagnes du tsar [1958], traduit du yiddish par Rachel Ertel, Paris, L’Antilope, 2019, 512 p.
2 « Sur les routes de Sibérie
On peut encore maintenant trouver un bouton, un lacet
De mes chaussures éculées, […] .
(Extrait des premiers poèmes publiés en 1915 par H. Leivick, après son évasion et son arrivée à New York, traduit et cité par Rachel Ertel dans sa préface à Dans les bagnes du tsar, p. 8-9).
3 Le détenu entend parler en lui « l’écrivain ». Il se demande comment « transformer en poème [qu’il] voudrait écrire » la réalité douloureuse et contradictoire qu’il découvre dans sa propre histoire et plus encore dans celle de ses compagnons de cellule (p. 188-193).
4 Dans la fièvre du typhus, Leivick entame un dialogue hallucinant avec le Christ, descendu du crucifix fixé au mur de la cellule pour « devenir un bagnard comme les autres » (p. 244-247).
5 Gottesbegriff nach Auschwitz, 1984, Munich, Grin Verlag
